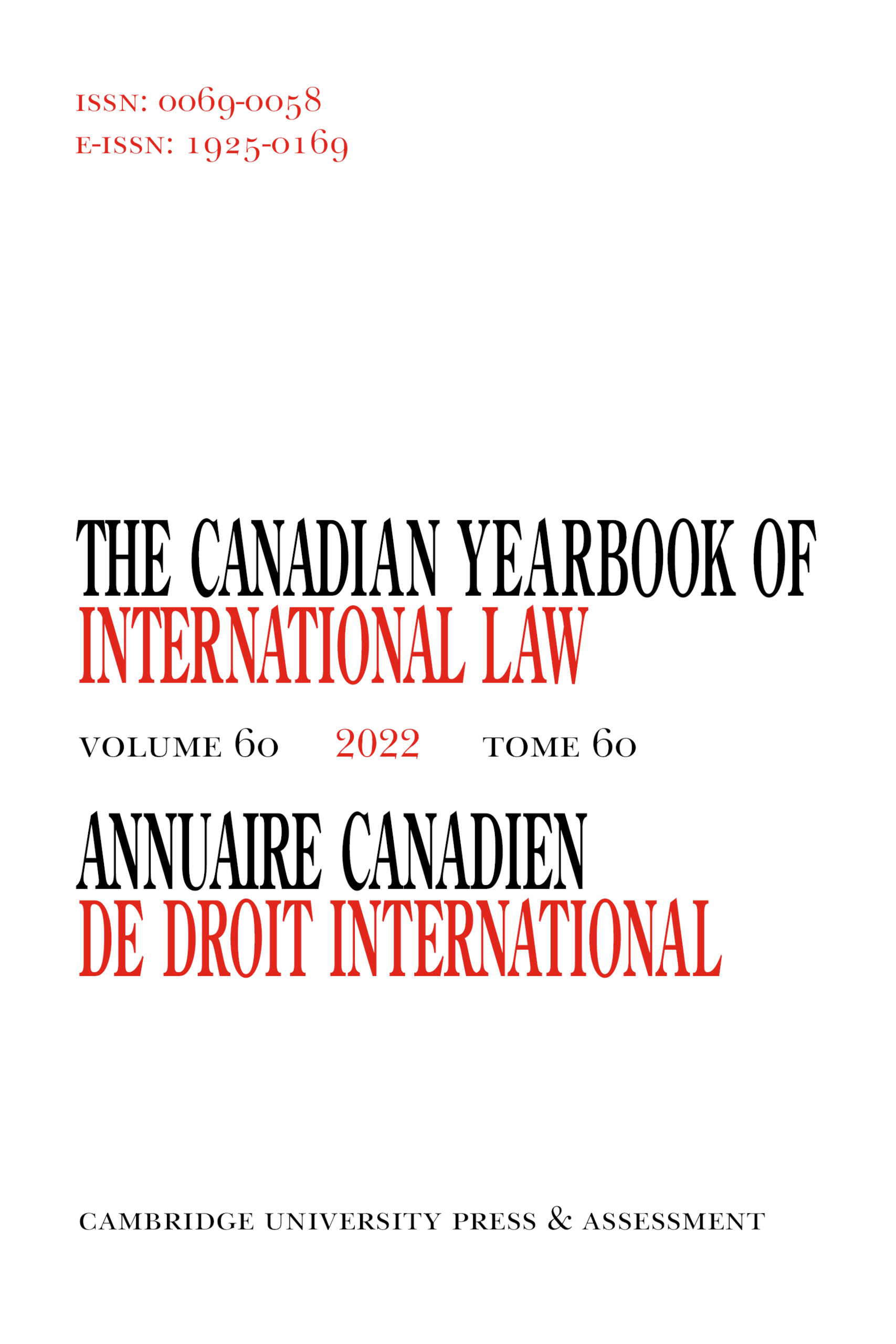1. Introduction
Le communiqué de presse d’Amnesty International faisant état de potentielles violations du droit international humanitaire (DIH) par l’Ukraine, publiée en août 2022, a soulevé de nombreuses critiques, certain-e-s lui opposant la cause légitime de la résistance ukrainienne face à l’agression russe. Il était notamment reproché aux forces ukrainiennes de placer des objectifs militaires à proximité de biens civils, ce qui dans de nombreux cas, constitue une violation du DIH.Footnote 1 Toutefois, l’État et le peuple ukrainiens faisant face à une invasion illégale, l’opportunité d’une telle publication posa dès lors question. Il est en effet largement admis au sein de la communauté internationale que l’invasion russe a été entreprise en violation de la Charte des Nations-Unies. Footnote 2 Mais cette immixtion d’une notion historiquement et intellectuellement liée au jus ad bellum — la cause légitime du peuple ukrainien — dans le domaine du jus in bello fut ensuite critiquée dans le champ du DIH au nom de la stricte séparation des deux domaines.Footnote 3 Symptomatique d’un habitus Footnote 4 professionnel au sein duquel la référence aux causes de la guerre et aux motivations des parties se voit invariablement opposer l’orthodoxie de la séparation entre jus ad bellum et jus in bello, cette réaction et le communiqué d’Amnesty International en lui-même expriment également un malaise plus large concernant la relation entre DIH et certaines formes de légitimité.
Partant de cela, le présent article cherchera à démontrer que les tentatives visant à isoler le DIH de certaines questions de légitimité, notamment celles liées aux causes de la guerre et à la nature et aux motivations des parties, sont à la fois vaines mais également à rebours de ce qu’est et de ce qu’a toujours été le DIH — un discours sur la violence légitime.Footnote 5 En s’attachant à distinguer certaines formes de légitimé ou de légitimation, le présent article se propose de préciser la nature et la fonction de la légitimité en DIH. Plus précisément, l’objectif est d’aller au-delà du rôle communément attribué au concept de légitimité en DIH, en s’intéressant notamment à la relation entre ce dernier et la nature et les motivations des acteurs impliqués dans les conflits armés, ainsi que les causes du recours à la force. Il sera avancé que cette forme particulière de légitimité en DIH se manifeste à travers deux modes de légitimation — l’un dérivant du statut, l’autre de la cause — à partir desquels la distribution de droits, devoirs, immunités, privilèges ou encore statutsFootnote 6 s’opère et se voit justifiée au sein du régime. Ce faisant, de nombreux discours empruntant au second registre, souvent qualifiés d’aberrations du point de vue du DIH ou dont la nature juridique est contestée, s’avèrent finalement être des arguments juridiques parfaitement valides et ancrés dans l’évolution et les logiques du DIH.
Rompant avec les approches orthodoxes faisant du DIH une simple réponse humanitaire aux “calamités de la guerre”Footnote 7 ou encore le point d’équilibre entre nécessité militaire et principe d’humanité,Footnote 8 le présent article se veut avant tout une intervention théorique concernant les biais structurelsFootnote 9 du DIH, que le conflit en Ukraine permet d’éclairer à nouveau. Le présent article s’appuiera ainsi sur les approches critiques du droit international et notamment sur leur traitement du DIH qui, bien que peu nombreuses, ont permis de dépasser les récits traditionnels concernant la nature et les fonctions de ce régime. Plus largement, le DIH sera également abordé en tant que langage étant caractérisé, à l’instar du reste du droit international, par son indétermination.
Dans un premier temps, la notion de légitimité explorée dans le présent article se verra précisée, mais aussi distinguée d’autres formes de légitimité à l’œuvre au sein du DIH et dont l’influence sur le régime est plus communément acceptée. Par conséquent, le jus ad bellum et le jus in bello, loin d’être hermétiquement séparés, seront présentés comme deux discours sur la violence légitime partageant une frontière poreuse. La distinction entre les deux régimes ne résidant alors non pas dans un supposé agnosticisme du DIH concernant les questions de légitimité, notamment des acteurs et des causes du recours à la violence, mais davantage dans une verbalisation différente de la légitimité de la guerre. Dans un second temps, il sera proposé d’envisager le DIH comme un régime structuré autour de deux conceptions concurrentes de la légitimité, l’une fondée sur la légitimité du statut, l’autre sur la légitimité de la cause. Un bref aperçu de certains développements du DIH et de l’inclusion progressive en son sein de certains acteurs et de certaines formes de violence collective permettra d’illustrer cette oscillation entre légitimité du statut et légitimité de la cause. Enfin, il sera défendu que la légitimité de la résistance à une invasion étrangère peut constituer un élément juridique parfaitement solubles dans la structure argumentative (indéterminée) du DIH, à même d’influencer l’application de ce dernier.
2. Droit international humanitaire et violence légitime
Si le droit exerce effectivement un rôle de légitimation, encore faut-il déterminer ce qu’une telle légitimation implique. Il sera donc proposé une conception de la légitimité permettant d’envisager que son rôle et son influence en DIH s’étendent vers des objets dont on la tient généralement écartée, en particulier les causes du recours à la force et la nature des acteurs impliqués dans les conflits armés. À la lumière de cette fonction particulière de la légitimité en DIH, c’est aussi la déconstruction de la supposée séparation stricte entre jus ad bellum et jus in bello qui peut s’envisager. L’idée sous-tendant cette séparation stricte suppose en effet que certaines questions de légitimité, notamment celles concernant le recours à la force, sont étrangères au DIH. Mais accepter qu’une telle idée soit sacrosainte et non sujette à discussion amène à ignorer les modalités propres du DIH par lesquelles ce dernier, tout comme le jus ad bellum, porte un regard sur les questions de recours à la force. Cette vision des choses apparait, comme nous le verrons, bien plus discutable depuis que les guerres de libération nationale (GLN), du fait de leur nature particulière, ont obtenu un statut à part au sein du DIH. Dès lors, la distinction entre les deux régimes, loin d’exprimer le rejet de l’un concernant les questions de légitimité au contraire de l’autre, s’explique davantage par des modalités de légitimation différentes. Partant de cela, il apparait nécessaire de considérer le DIH de manière critique afin de saisir la complexité de ce dernier — au-delà d’un simple ensemble de règles cherchant à limiter la violence pendant la guerre.Footnote 10
A. Les multiples facettes de la légitimité en droit international humanitaire
Le couple légalité et légitimité est l’un de ces couples ayant connu un grand succès au sein de la discipline du droit et plus généralement au sein des sciences sociales.Footnote 11 Si bien que la notion de légitimité, bien que constamment utilisée, demeure difficilement réductible à une définition unique. Face à cette profusion de définitions ou d’usages, la notion de légitimité est souvent utilisée avec une présomption d’intelligibilité immédiate. Cette manière de procéder encoure toutefois le risque de très vite retomber sur une compréhension superficielle mais aussi restreinte de la légitimité, ignorant par-là ses multiples facettes. Comme l’avait bien montré Max Weber, la légalité est devenue l’une des formes principales d’expression de la légitimité.Footnote 12 Et bien que le présent article n’ait évidemment pas l’ambition de proposer une définition universelle de la notion de légitimité, il se propose en revanche d’avancer une conception de la légitimité permettant d’éclairer ce que peut signifier, en DIH mais plus généralement en droit (international), le fait de légitimer.
L’idée selon laquelle le DIH serait hostile aux questions de légitimité est évidemment fondée sur un paradoxe tant le champ lexical de la légitimité infuse le régime. On parle ainsi de “cibles militaires légitimes” ou encore “d’objectifs militaires légitimes.”Footnote 13 La Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 tient par ailleurs son statut de texte fondateur du DIH de son préambule qui opère explicitement une distinction entre violence légitime et illégitime:
[L]e seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi; Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possible. Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable; Que l’emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l’humanité.Footnote 14
De cette construction découle l’idée que diriger délibérément la violence vers les non-combattants, les personnes hors de combat ou encore des biens de caractère civil ne s’inscrit pas dans la poursuite du “seul but légitime” de la guerre. Autrement dit, “la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin.”Footnote 15
D’après Jean d’Aspremont, c’est d’ailleurs dans ce rôle de (dé)légitimation des comportements, dont on peut tracer l’origine à la Déclaration de Saint-Pétersbourg, que se trouve la raison d’être et la pertinence du DIH:
[Traduction] Le DIH est devenu un vocabulaire argumentatif universel utilisé pour discuter du bien et du mal dans les conflits […] En ce sens, nous assistons à une montée en puissance du DIH plutôt qu’à un déclin. La doctrine et le vocabulaire du DIH sont invoqués en permanence, partout et par toute une série d’acteurs pour légitimer ou délégitimer des comportements dans les conflits armés. De ce point de vue, les arguments qui réduisent le DIH à l’insignifiance au motif qu’il n’a qu’un impact limité sur les acteurs ne tiennent pas, car le DIH peut difficilement jouer un rôle plus influent que celui d’être le vocabulaire de référence pour toute revendication concernant l’acceptabilité des comportements des acteurs engagés dans des conflits armés.Footnote 16
La notion de légitimité implique donc ici de mesurer l’acceptabilité de certains comportements à la lumière des règles du DIH, ce dernier constituant “un vocabulaire de persuasion sur la légitimité.”Footnote 17 Le but ultime est ainsi de rendre socialement acceptable ou non certains actes de violence militaire. Dans ce contexte ou dans d’autres, apposer le sceau de la légitimité ou de l’illégitimité implique donc l’émission d’un jugement ou d’une évaluation. Discutant de l’existence d’un “principe de légitimité” dans le droit international de l’entre-deux guerres, Carl Schmitt rapprocha la notion de légitimité à celle de “normalité politique.”Footnote 18 Légitimer ou délégitimer reviendrait dès lors à recourir à “des principes concrets permettant un jugement sur le point de savoir si un état des choses […] est normal” et par là même “normativement idéal.”Footnote 19 Selon la Déclaration de Saint-Pétersbourg, il est en ce sens “normativement ideal,” ou encore souhaitable, désirable ou juste de mener la guerre avec des armes n’étant pas à même de causer de maux superflus.
Finalement, ce n’est pas le registre de la légitimité à l’encontre duquel le DIH serait hostile tant il semble accepté, même implicitement, que ce dernier porte ou peut être mobilisé pour porter des jugements sur les comportements des acteurs prenant part à des conflits armés. Ce qui semble en revanche contesté, c’est la possibilité que le DIH puisse porter ou puisse être mobilisé pour porter de tels jugements au-delà de cette fonction particulière. Pour cette raison, et comme le note très justement Jean d’Aspremont, le DIH a été constamment “dépeint et enseigné comme étant à l’abri […] et étranger aux évaluations liées à la légitimité.”Footnote 20 En particulier, c’est la possibilité que de tels évaluations ou jugements puissent déterminer l’application du DIH qui est rejetée.Footnote 21 Or, il est avancé dans le présent article que si le DIH vise en effet une “normativité idéale” à laquelle devrait correspondre la guerre, l’évaluation des comportements ne constitue qu’une des facettes de ce processus de légitimation. Ce processus de légitimation, que DIH et jus ad bellum se partagent, implique trois dimensions. Pour que la guerre soit “normativement idéale,” il conviendrait donc de porter des jugements sur la manière dont cette dernière doit être menée, pour quelle raison, et par quels acteurs.
Traditionnellement, le DIH s’est vu cantonné à la première dimension, tandis que les deux autres demeuraient l’apanage du jus ad bellum. Il sera toutefois avancé que le DIH porte des jugements et permet d’en porter non seulement sur la manière dont est menée la guerre, mais aussi par qui elle est menée et pour quelle raison. Cela implique alors de reconsidérer ce que Tom Ruys présente comme la meilleure illustration de la supposée aversion du DIH pour les questions de légitimité, à savoir la dissociation entre jus ad bellum et jus in bello. Footnote 22
B. Le droit international et la fragmentation de la légitimité de la guerre
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et à plus forte raison depuis la mise en place du système onusien, il est conventionnellement admis que le droit international s’emploie à réguler la guerre à travers deux régimes différents et distincts: le jus ad bellum et le jus in bello. Le premier encadre le recours à la force, et dans le système actuel de la Charte des Nations-Unies, interdit le recours à la force hormis en cas de légitime défense ou de décision du Conseil de sécurité.Footnote 23 Trouvant ses origines dans le Traité de Versailles et dans le Pacte Briand-Kellog, il s’agit ici d’un régime beaucoup plus récent que le jus in bello. Ce dernier est en effet apparu dans sa version moderne et codifiée durant la seconde partie du XIXème siècle. Pendant plusieurs décennies, le droit international ne s’intéressait alors supposément qu’à la conduite de la guerre. Aujourd’hui, et malgré le fait que certaines guerres peuvent être qualifiées d’illicites, il est communément admis que la légalité ou les raisons du recours à la force n’exercent aucune influence sur l’application du DIH.Footnote 24 Dès 1953, Hersh Lauterpacht se posait la question de l’application des règles du DIH dans le cas d’une guerre illicite au regard de la Charte des Nations-Unies. Footnote 25 D’après ce dernier, le DIH demeurait malgré tout applicable à toutes les parties, qu’il s’agisse d’un État agresseur ou d’un État exerçant son droit à la légitime défense.Footnote 26 Cette approche avait pour objectif pragmatique d’assurer que certaines règles s’appliqueraient en cas de conflits armés dans la perspective assez probable d’une violation du jus ad bellum, “une deuxième digue.”Footnote 27
Comme évoqué précédemment, l’approche orthodoxe au sein de la discipline tend à considérer le jus ad bellum et le jus in bello comme étant hermétiquement séparés. Loin d’être anodin, ce postulat influence la manière dont les deux régimes sont perçus. D’une part, admettre que la Charte des Nations-Unies comporte des considérations morales de justice ou permet d’aborder les questions de légitimité par la différentiation qu’elle effectue entre recours à la force légitimes et illégitimes — entre guerres justes et injustes pourrait-on également dire — ne semble pas constituer un saut qualitatif insurmontable. La Charte des Nations-Unies a ainsi été considérée par certains comme participant d’une renaissance des doctrines de la guerre juste.Footnote 28 D’autre part, le DIH serait quant à lui pragmatique et agnostique concernant la guerre.Footnote 29 En d’autres termes, qu’une guerre soit licite, légitime ou encore juste n’exercerait aucune influence sur l’application du DIH. Pour le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), le DIH “traite […] de la réalité d’un conflit sans considération des motifs ou de la légalité d’un recours à la force” et ses “dispositions s’appliquent également à l’ensemble des parties au conflit, indépendamment des motifs du conflit et de la justesse de la cause défendue par l’une ou l’autre partie.”Footnote 30
Cette approche de la relation entre jus ad bellum et jus in bello, largement dominante dans le champ du DIH,Footnote 31 semble constituer une sorte de Grundnorm du régime tant elle apparait fondamentale sans qu’il soit pour autant nécessaire — ou même possible — d’en justifier les fondements.Footnote 32 Cette stricte séparation des deux régimes entraine également une dépolitisation du DIH. On trouverait ainsi d’un côté un jus ad bellum susceptible d’être politisé au regard de ses préoccupations concernant les causes de la guerre et la nature des acteurs y étant impliqués, et à l’inverse, un jus in bello pragmatique et à “vocation purement humanitaire.”Footnote 33 Cela dénote plus globalement d’une vision libérale réduisant le droit à “une question juridico-technique et non plus éthico-politique.”Footnote 34 Pourtant, bien que largement réprimées, les questions de légitimité demeurent au cœur du DIH.
En premier lieu, il parait assez étrange que soit encore soutenue l’idée d’une séparation absolue entre jus ad bellum et jus in bello depuis l’entrée en vigueur du Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève (PAI). En effet, le paragraphe 4 de l’article 1 de ce dernier élève au rang de conflits armés internationaux (CAI) les “conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.”Footnote 35 Ainsi, durant les GLN, les causes de la guerre et la qualité des acteurs constituent un élément déterminant de la qualification juridique du conflit, et par là même, modifient les règles de DIH applicables. L’exemple paradigmatique étant l’octroi du privilège du combattant aux membres de groupes luttant “contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes” et exerçant leur droit à l’autodétermination, garantissant théoriquement à ces derniers le statut de prisonnier de guerre. À l’inverse, les groupes luttant contre leur propre gouvernement en dehors des causes énumérées dans l’article 1(4) demeurent soumis aux règles des conflits armés non-internationaux (CANI). Ne jouissant pas du privilège du combattant, les individus prenant part à un CANI peuvent dès lors être poursuivis pour leur simple participation aux hostilités. En incorporant des considérations relatives aux causes de la guerre et à la nature des acteurs et de leurs motivations, l’article 1(4) contredit donc la stricte séparation entre jus ad bellum et jus in bello. Lors des négociations du PAI, l’article 1(4) a par ailleurs été perçu, notamment par les États-Unis, comme l’émanation du “dangereux concept de guerre juste.”Footnote 36
Il serait toutefois réducteur de voir dans la catégorie des GLN l’unique exception confirmant la règle voulant que le DIH se tienne à distance des questions de légitimité. Ce refoulement de la relation entre DIH et légitimité s’explique, comme évoqué dans la section précédente, par une vision restreinte de l’influence exercée par les questions liées à la légitimité en DIH. Seul le jus ad bellum serait ainsi porteur d’un discours sur la légitimité de la guerre en tant que telle, le DIH restant muet sur la question. Toutefois, malgré leur interaction, voire fusion au sein du PAI, qui fragilise ce postulat, il ne s’agit pas pour autant d’avancer que la distinction entre jus ad bellum et jus in bello s’effacerait totalement au bénéfice d’une doctrine de la guerre juste confondant totalement jus ad bellum et jus in bello. Dans ce type de système,Footnote 37 toutes les dimensions de légitimité de la guerre, cause, nature et motivations des acteurs, et manière de la mener devaient être saisies globalement, ou de façon quelque peu anachronique, par un seul régime juridique. Cependant, dans un droit international moderne caractérisé par sa fragmentation,Footnote 38 il est possible qu’une guerre soit licite selon la Charte des Nations-Unies, mais que sa conduite soit émaillée de violations massives du DIH, et inversement. Une guerre qui est présentée comme légale dans les deux régimes sera davantage considérée comme légitime. Grâce à l’autorisation du recours à la force par le Conseil de Sécurité, combinée aux autoproclamations répétées de respect du DIH,Footnote 39 la guerre de 1991 contre l’Irak menée par la coalition dirigée par les États-Unis a par exemple bénéficié de la “réputation de guerre la plus propre et légale de l’histoire.”Footnote 40 Mais il serait également possible d’imaginer une argumentation juridique par laquelle une violation de la Charte des Nations-Unies se verrait atténuée par une proclamation de respect du DIH, ou encore une situation dans laquelle des violations massives du DIH se verraient opposer la licéité initiale du recours à la force.
Il s’agit donc de considérer ici le DIH, tout comme le jus ad bellum contemporain et les anciennes doctrines de la guerre juste, comme des “discours politiques sur la violence légitime.”Footnote 41 Les modalités de légitimation ont toutefois changé à travers le temps et sont plus diffuses dans le droit international moderne qu’elles ne l’étaient dans les anciennes doctrines de la guerre juste. Dès lors, la proximité, mais aussi les différences entre le jus in bello et le jus ad bellum s’expliquent par le fait qu’il s’agit de deux régimes distincts de légitimation, qui tous deux, sont néanmoins engagés dans la fabrique de la guerre en tant qu’institution juridique.
C. Droit international humanitaire et institutionnalisation de la guerre
Comme évoqué précédemment, le DIH peut permettre de mesurer la légitimité de la guerre en fonction de la manière dont celle-ci est conduite. Le degré de respect accordé aux règles et principes du DIH, réel ou supposé, devient ainsi la mesure de la légitimité. Pendant la Première Guerre mondiale, le DIH a par exemple été davantage utilisé par les belligérants pour délégitimer leurs adversaires que pour incorporer ses règles sur le champ de bataille.Footnote 42 Toutefois, la (dé)légitimation de la violence par le DIH ne s’exprime pas seulement — ni même principalement — par la distinction entre le fait de mener la guerre selon les règles ou non. Il serait en effet trompeur d’affirmer que le DIH se concentrerait uniquement sur la manière légitime de mener la guerre. La limitation de la violence dans la conduite de la guerre est de fait l’expression ultime du DIH, mais elle résulte de la légitimation initiale de l’activité elle-même et des acteurs qui y participent. Afin de mieux cerner par quel biais le DIH peut être considéré comme un discours sur la violence légitime, il convient toutefois de s’extraire de l’historicisme fonctionnaliste si présent dans le champ.
Par historicisme fonctionnaliste, il est ici fait référence à une tendance qui dépasse les frontières du DIH et du droit international et qui est caractéristique du champ juridique en général. Le point de départ de cette approche est de présenter le droit et la société comme des “catégories sociales séparées.”Footnote 43 L’interaction entre ces deux catégories se comprend alors par une relation dans laquelle “les sociétés [auraient] des besoins” et “le droit s’adapterait” à ces derniers.Footnote 44 L’évolution historique du droit est alors mesurée selon que ce dernier parvienne à satisfaire ou non ces exigences sociales.Footnote 45 Concernant la guerre, il peut alors être avancé que les juristes ou encore les humanitaires et les militaires, en tant qu’observateurs attentifs de la réalité sociale, constatèrent l’existence d’un besoin objectif de réguler la guerre afin d’en limiter la violence. Une approche plus féconde consiste pourtant à considérer la dialectique droit-société dans l’autre sens afin d’illustrer comment le droit construit également les besoins sociaux.Footnote 46 En d’autres termes, comment le droit construit la réalité sociale qu’il se propose de réguler.Footnote 47
Dans le cadre du DIH, cet historicisme fonctionnaliste se matérialise dans le récit humanitaire dominant. Face aux “calamités de la guerre” émergea ainsi l’exigence sociale de limiter la violence.Footnote 48 Le DIH est alors généralement présenté comme “un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés.”Footnote 49 Cette approche s’accompagne bien souvent d’un discours historique tout orienté vers la notion de progrès et dans laquelle le DIH est uniquement présenté et célébré comme un projet purement humanitaire, à la fois en rupture avec un passé barbare, tout en étant la consécration d’idées humanitaires dont on trace une généalogie millénaire.Footnote 50 Pourtant, comme l’a montré David Kennedy, et en écho à la (dé)légitimation des comportements évoquée précédemment, le DIH serait davantage un vocabulaire commun utilisé à la fois par les humanitaires et les militaires pour défendre des projets concurrents concernant “la limitation et l’exercice de la puissance militaire.”Footnote 51 Une lecture uniquement humanitaire du DIH empêche dès lors la prise en compte des projets contradictoires pouvant être poursuivis à travers ce dernier. Or, s’il est souvent avancé que le DIH constitue un point d’équilibre entre principe d’humanité et nécessité militaire, cette dialectique illustre davantage les “dynamiques de contradiction” du régime qu’une balance de projets contradictoires.Footnote 52 Dans un geste similaire à ce que Martti Koskenniemi avance dans son ouvrage From Apology to Utopia, le couple principe d’humanité et nécessité militaire illustrerait plutôt la structuration du DIH autour de “deux modèles — ou ensembles d’arguments — […] à la fois exhaustifs et mutuellement exclusifs.”Footnote 53 Chacun des deux modes d’argumentation étant à la fois valide tout en étant simultanément “vulnérable aux critiques de leur opposé,”Footnote 54 l’opposition apologie/utopieFootnote 55 s’illustre dans le fait que le DIH constitue un langage pouvant être utilisé à la fois par ceux qui tentent de justifier la violence armée et par ceux qui tentent de s’y opposer.Footnote 56
Envisager le DIH uniquement à travers le prisme humanitaire, et par là même ignorer les dynamiques de contradiction à l’œuvre, tend naturellement à influencer la manière dont sont formulées les problématiques propres au régime. Par conséquent, le dilemme fondateur au sein du champ semble se structurer autour de l’idée que le DIH “est respecté par certains, déformé par d’autres, et ignoré par beaucoup.”Footnote 57 Les violations constantes du DIH ou les tentatives de justifications de ces dernières sont donc rejetées comme un mauvais usage du régime mais jamais perçues comme de potentiels sous-produits du dispositif lui-même. Considérant la guerre comme un aspect inévitable des sociétés humaines, la logique humanitaire — loin d’être abolitioniste — implique de traiter cette dernière de manière pragmatique afin de limiter “l’usage de la violence.” Toutefois, être suspicieux vis-à-vis de ce discours humanitaire n’implique pas que l’exacte opposé serait plus plausible. Mettre en avant le rôle plus ambigu du DIH vis-à-vis de la violence n’équivaut pas à présenter ce dernier comme un pâle reflet des intérêts militaires. Le présent article défend cependant que le DIH entretient une relation plus contrastée avec la violence, allant au-delà d’une simple fonction de limitation. Au-delà du récit humanitaire, certain-es chercheur-es critiques ont néanmoins tenté de faire ressortir les biais structurels du DIH. Ces approches critiques ont en commun de contester l’idée que l’humanitarisme constitue un prisme pertinent ou suffisant à travers lequel le DIH peut être appréhendé. Certain-es ont ainsi montré les origines, dimensions ou biais étatistes,Footnote 58 coloniauxFootnote 59 et antirévolutionnairesFootnote 60 du DIH. Ce dernier a également été dépeint comme un outil facilitant ou conduisant à la violence militaire et aux atrocités,Footnote 61 tandis que d’autres ont tenté de mettre l’accent sur les luttes politiques ayant emmaillé les négociations de textes majeurs.Footnote 62 Commun à nombreux de ces travaux est l’accent mis sur le rôle constructif du droit par rapport à la guerre. Plus qu’un simple fait social, la guerre est appréhendée comme une institution juridique, comme quelque chose “d’essentiellement construit par le droit”:Footnote 63
[Traduction] Plutôt que de s’opposer à la guerre, le droit a depuis longtemps été directement impliqué dans la construction de la guerre — la construction de la guerre comme une sphère distincte de l’activité humaine dans laquelle les règles “normales” de la vie sociale, codifiées, par exemple, dans le droit pénal national réglementant la violence, ne fonctionnent pas.Footnote 64
Ainsi, si le DIH établit des limites, ces dernières s’appliquent dans un contexte de “disculpation collective”Footnote 65 au sein duquel tuer, détruire ou encore priver de libertés des individus échappent à la sphère pénale.Footnote 66 Cette construction de la guerre comme institution juridique exceptionnelle implique dès lors une activité de catégorisation par laquelle le droit détermine ce qui se trouve en dedans et en dehors de ses catégories.Footnote 67 Ici, “la construction juridique de la guerre sert à canaliser la violence vers certaines formes d’activités pratiquées par certains types de personnes, tout en excluant d’autres formes pratiquées par d’autres personnes.”Footnote 68 En d’autres termes, la construction juridique de la guerre à travers le DIH est fondamentalement un “discours sur la violence légitime”Footnote 69 à travers lequel la distinction guerre/non-guerreFootnote 70 opère constamment. Par son travail de catégorisation, le DIH se prononce ainsi sur la légitimité de certaines situations de violence collective qu’il inclue, et sur l’illégitimité d’autres situations qu’il exclue. Distribuant droits, devoirs, privilèges et statuts parmi différentes communautés politiques, le DIH octroie par là même différents degrés de légitimité aux types de conflits qu’il se propose de réguler, ainsi qu’aux acteurs impliqués dans ces derniers.
En ce sens, le DIH véhicule des jugements sur la “normativité idéale” à laquelle devrait correspondre la guerre. Il s’agit ici d’un élément faisant du jus in bello un régime entretenant des similitudes évidentes avec le jus ad bellum. La différence bien réelle entre les deux régimes s’exprime toutefois dans la structure particulière prise par la notion de légitimité dans l’évolution du régime. Il est en effet défendu que ce dernier est partagé entre deux conceptions contradictoires de la légitimité, l’une ancrée dans la légitimité du statut, l’autre dans la légitimité de la cause. Comprendre cette tension structurante du DIH et son évolution permet alors d’envisager ce dernier à travers sa complexité et ses contradictions, étendant ainsi le champ discursif du DIH vers des arguments, concepts ou encore critiques bien souvent considérés, sans grand examen, comme étant étrangers au régime.
3. Légitimité du statut et légitimité de la cause: tension structurante du droit international humanitaire
Forme de violence “la plus sociale,”Footnote 71 la guerre est intimement liée à l’État comme institution politique détentrice (ou se réclamant être détentrice) du monopole de la violence légitime.Footnote 72 L’émergence de l’État moderne européen s’est d’ailleurs accompagnée de la monopolisation de la guerre comme compétence purement étatique.Footnote 73 Par conséquent, la guerre est indissociable du principe de souveraineté. En tant que régime juridique ayant émergé avec pour but originel d’uniquement réguler les relations étatiques, la naissance du DIH peut être appréhendée comme une tentative, principalement imaginée par et pour des États européens,Footnote 74 de non seulement limiter, mais aussi de rationaliser entre eux ce pouvoir souverain. Cette section s’attache donc à faire ressortir cet aspect décisif par lequel le régime s’est inscrit dans un processus plus large de légitimation d’une forme particulière de guerre, menée par des acteurs particuliers. À travers les exemples de la levée en masse et des GLN, il sera ensuite montré que cette conception de la légitimité a été concurrencée, faisant ainsi du DIH un régime oscillant entre deux conceptions de la légitimité, l’une fondée sur le statut, l’autre sur la cause.
A. L’État comme source de légitimité
Avant l’adoption de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, le DIH conventionnel s’appliquait théoriquement uniquement aux conflits entre États. Texte fondateur du DIH, la Déclaration de Saint-Pétersbourg opéra dès 1868 l’exclusion explicite des peuples colonisés et des groupes se révoltant contre leur gouvernement des lois de la guerre.Footnote 75 Dès ses origines, le DIH reposait ainsi sur le mode de la distinction guerre/non-guerre. Par cette même distinction, différentes communautés politiques se voyaient inclues ou exclues des droits, devoirs, privilèges et statuts du DIH. Construisant la guerre comme activité légitime, le DIH n’impliqua dès lors pas seulement de tracer la frontière de ce qu’il était permis de faire ou non durant cette dernière, mais aussi et avant tout de tracer la frontière entre acteurs légitimes et illégitimes de cette “activité sociale.”Footnote 76 En cela, et comme l’avance Nathaniel Berman, le privilège du combattant constitue la doctrine centrale du DIH.Footnote 77 Ce privilège du combattant peut notamment se définir comme suit:
[Traduction] il s’agit d’une immunité de droit international qui place certaines actions violentes et certains acteurs en dehors du champ d’application du droit pénal “normal” et des droits humains. Ceux qui bénéficient du privilège du combattant ne peuvent être poursuivis pour une simple participation à un conflit armé et ont droit au statut de prisonnier de guerre.Footnote 78
Construit sur des biais étatistes, le DIH reposait sur l’idée que les États et les membres de leurs forces armées constituaient les sujets légitimes de la guerre, rejetant tout autre acteur dans la sphère de la criminalité ou de l’état d’exception. Tous droits, devoirs ou privilèges émanant du DIH découlaient ainsi de la légitimité du statut étatique. En d’autres termes, la catégorie de combattant, et le privilège en découlant, sont attachés “à la figure de l’État souverain dont le combattant reçoit le privilège de la destruction légitime.”Footnote 79 Alors que la souveraineté étatique était bien souvent déniée aux peuples non-européens, cette légitimité découlant du statut étatique n’était pas uniquement fondée sur des biais étatistes, mais aussi sur des biais coloniaux.Footnote 80 Loin d’être apolitique ou neutre, cette construction de l’État comme sujet légitime de la guerre ne découlait pas du fait que ce dernier eut été le sujet naturel du système international. Comme avancé précédemment, le droit construit les objets et les sujets qu’il se propose de réguler.Footnote 81 Ce n’est que par la suite que ces derniers sont naturalisés, laissant ensuite à penser que le droit ne constitue qu’une simple réaction à des problématiques préexistantes. Dans le cas présent, le DIH ne s’est pas construit autour de l’État comme entité naturelle voire transcendantale, mais participait d’un “discours de construction de la centralité de l’État.”Footnote 82 Dans le contexte particulier de la guerre, une des fonctions du DIH, par l’intermédiaire de cette légitimité du statut, fut de “limiter les possibilités d’imaginer des formes de juridicité autres que celles émanant des États.”Footnote 83 Si cette légitimité du statut peut dès lors aisément camoufler ses biais politiques derrière un formalisme trompeur, elle s’inscrit néanmoins dans une vision du monde particulière et ne peut donc être séparée des questions de légitimité. N’ayant jamais dissimulé ses biais en faveur d’une vision absolutiste de l’État et de la domination coloniale européenne, Carl Schmitt voyait par exemple dans la codification du droit de la guerre une étape essentielle de la construction d’un système de droit international établissant la “supériorité juridique” de l’État et la fixation “d’un statu quo [lui étant] favorable.”Footnote 84 Ce dernier vit d’ailleurs avec horreur l’expansion du champ d’application du DIH aux CANI avec l’article 3 commun aux Conventions de Genève, voyant dans ce processus une étape de la “désétatisation” du droit international.Footnote 85 Toutefois, loin de renverser un étatisme ancré dans la légitimité du statut, la catégorie des CANI vint seulement amender cette dernière, gardant l’État comme horizon indépassable du champ de la violence légitime.
B. Le spectre de l’État dans la régulation des conflits armés non-internationaux
La catégorie de CANI englobe ce que l’on nomme communément les guerres civiles. Les règles concernant ces dernières ont principalement été codifiées à travers l’article 3 commun aux Conventions de Genève et le Second protocole additionnel (PAII) de ces mêmes conventions.Footnote 86 Si la catégorie de CANI incluait également les conflits coloniaux en 1949, le PAI est venu inclure ces derniers dans la catégorie des CAI à partir de 1977 (voir ci-dessous). Et bien que l’inclusion des conflits internes dans le champ du DIH a, de façon peu surprenante, longtemps été combattue par les États, elle n’a toutefois pas ébranlé l’association entre violence légitime et souveraineté étatique.
Comme avancé depuis le début du présent article, la qualification juridique des conflits constitue un exercice éminemment politique à travers lequel divers degrés de légitimité sont attribués à différents types de conflits et aux acteurs impliqués dans ces derniers. Dans le cas des CANI, cette qualification est pourtant souvent présentée comme une simple technicalité. Ainsi, en fonction du type de CANI, l’organisation des groupes armés non-étatiques (GA), l’intensité des hostilités ou dans certains cas le contrôle territorial exercé par les GA sont supposés permettre de déterminer objectivement l’existence ou non d’un conflit armé et de distinguer ce dernier “du banditisme, d’insurrections inorganisées et de courte durée ou d’activités terroristes.”Footnote 87 La qualification juridique d’un conflit serait ainsi une question purement factuelle.Footnote 88 En outre, le DIH aurait aussi complètement rompu avec de telles considérations en abandonnant la doctrine de la reconnaissance de belligérance, qui par nature était conditionnée par un acte de reconnaissance vulnérable aux questions de légitimité.Footnote 89
La reconnaissance de l’existence d’un conflit armé est au contraire largement abordée sous l’angle du test. Les faits sont supposés être analysés à travers le prisme des tests d’intensité et d’organisation ou encore de contrôle territorial pour déterminer s’ils correspondent aux critères d’un conflit armé. S’il n’existe pas de liste exhaustive d’indicateurs permettant de vérifier la réalisation de ces critères, la manière dont ces tests ont été réalisés par les tribunaux internationaux montre une combinaison d’éléments qualitatifs et quantitatifs donnant une dimension technique au processus. Cette combinaison d’éléments qualitatifs et quantitatifs est bien illustrée par certains des faits invoqués par les différents tribunaux internationaux: la durée des hostilités, les attaques contre des villages ou des villes, le nombre de réfugiés, l’établissement de postes de contrôle, l’augmentation des attaques, le ciblage des populations civiles et des forces de sécurité, le bombardement de bâtiments, l’établissement d’une forme d’administration et l’existence de quartiers généraux, de zones d’opération désignées pour un groupe armé.Footnote 90 Ce processus donne ainsi l’impression d’un exercice libéré de toute considération politique ou morale concernant la légitimité de l’usage de la violence.
Toutefois, que le seul critère pertinent ne soit pas uniquement un critère d’intensité rend difficile l’assimilation de la guerre à un élément purement factuel. Davantage qu’une transformation complète du régime, ce processus d’inclusion des conflits internes procède plutôt d’une forme de bricolage.Footnote 91 En effet, “le modèle du conflit interétatique persiste comme base de l’applicabilité du jus in bello” et “l’inclusion de certains conflits armés non interétatiques s’est faite sur la base de leur ressemblance avec ces conflits.”Footnote 92 Comme l’indique Alejandro Lorite Escorihuela, cette inclusion des conflits internes ne rompt pas avec l’association entre État et violence légitime:
[Traduction] Les conflits armés non-internationaux sont considérés comme des conflits armés car la nature des violences affecte — directement ou indirectement — le souverain lui-même. La situation paradigmatique se produit lorsque le représentant du souverain est renversé, mais un autre cas peut être celui de la perte de contrôle du gouvernement sur le territoire du souverain au point qu’une “guerre” y est menée, avec ou sans sa propre participation.Footnote 93
Par organisations armées on entend ainsi “des groupes représentant soit l’État, soit étant capables de concurrencer le contrôle étatique par l’usage de la violence.”Footnote 94 Les droits et devoirs que le DIH octroie aux groupes armés non-étatiques engagés dans un CANI sont donc conditionnés au fait que cette violence s’inscrit dans un usage étatique ou quasi-étatique de cette dernière, conservant ainsi intacte la structure du système international. Comme l’avance Nathaniel Berman, “les Conventions de Genève, ainsi que les Protocoles de 1977 […] favorisent systématiquement des groupes puissants, bien organisés et obsédés par le territoire — qu’ils soient des États ou des proto-États — au détriment de réseaux moins puissants, désorganisés, liés à l’échelle transnationale, et dont les objectifs ne sont pas centrés sur le territoire.”Footnote 95 Loin d’être neutres, les critères d’organisation ou de contrôle territorial permettent plutôt de s’assurer que les groupes reconnus comme groupes armés soient des proto-États, de potentiels futurs États. C’est sur cette base que le DIH légitime, en partie, les conflits internes. Avec l’octroi de certains droits et devoirs aux acteurs non-étatiques impliqués dans une guerre civile, cette forme de violence entre en partie dans la sphère de la violence légitime.
Toutefois, en refusant aux membres de GA le privilège du combattant et le statut de prisonnier de guerre, le DIH permet aux États de poursuivre pénalement ces derniers pour le simple fait d’avoir participé aux hostilités. Cette inégalité de traitement et cette oscillation entre violence légitime et criminalité s’explique par l’équilibre particulier que tente de performer le DIH dans cette situation. Il fut en effet envisagé une entorse au principe de l’égalité des belligérants. Ce principe central selon lequel le DIH s’applique “d’une manière égale à toutes les Parties au conflit”Footnote 96 est si ce n’est absent,Footnote 97 du moins limité durant les CANI. Et pour cause, ce principe découle directement de cette légitimité du statut fondé sur la qualité étatique des acteurs impliqués dans les conflits armés. Le compromis qui a été nécessaire pour convaincre les États d’inclure les guerres civiles dans le champ du DIH a ainsi pris la forme d’une double garantie offerte par ce dernier pour assurer la perpétuation du statut étatique comme source principale de légitimité au sein du système international. Au-delà d’assurer une humanisation des guerres civiles, le DIH supporte également, et de manière il est vrai peu surprenante, le statu quo en favorisant les gouvernements établis en refusant le privilège du combattant aux rebelles, insurgés ou encore révolutionnaires. En ce sens, l’égalité des belligérants dans les CANI (du moins dans les CANI opposant l’État et des GA et non pas uniquement des GAFootnote 98) demeure largement virtuelle. Néanmoins, le DIH accompagne simultanément la possibilité d’une remise en cause violente de ce statu quo en accordant certains droits et devoirs aux groupes combattant le gouvernement légal, à condition que cette violence s’ancre dans la poursuite — légitime — de l’exercice et de la conquête du pouvoir étatique.
Loin d’être neutre, purement humanitaire ou encore apolitique, cette légitimité du statut dont découlent les droits, devoirs, privilèges et statuts que le DIH distribue s’accompagne d’une vision particulière et orientée à travers laquelle la légitimité de la violence et des acteurs du système international est évaluée. Toutefois, le formalisme de cette conception de la légitimité autour du statut étatique a été concurrencé, et continue de l’être, par une conception de la légitimité assumant davantage son contenu politique.
C. Levée en masse et guerres de libération nationale: résistance et contre-violence légitimes
Problématique contemporaine majeure, la question des combattants irréguliers fut un débat constant de l’histoire du DIH. Les conférences de la Haye de 1899 et 1907, et à plus forte raison la conférence de Bruxelles de 1874, étaient encore marquées du souvenir de la guerre franco-prussienne de 1870 dans laquelle les francs-tireurs avaient constitué une question délicate. Face à la résistance de ces combattants irréguliers, la pratique prussienne avait été une politique d’exécution systématique, déniant à ces derniers tout droit de résistance ou de se réclamer des lois de la guerre.Footnote 99 Non-membres des forces armées régulières, le recours à la violence des francs-tireurs n’était pas sanctionné par l’État et allait donc à l’encontre du formalisme de la légitimité du statut. Partant de cette construction originelle restrictive, l’évolution du DIH peut également se voir à travers le prisme d’une lutte pour dépasser ce carcan du statut étatique comme unique source de légitimité. Face à l’impossibilité d’inscrire certains types de combat dans une telle forme de légitimité, il fut donc nécessaire de mettre de l’avant des causes dont la valeur morale ou politique pourrait justifier une conception différente de la légitimité. Les catégories de levée en masse et de guerres de libération nationale constituent deux exemples de cette inclusion des causes de la guerre et des motifs du recours à la force comme source de légitimité au sein du DIH.
Concept issu de la Révolution française, la levée en masse fut pour la première fois incorporée dans le droit positif dans le Règlement de la Haye de 1907,Footnote 100 bien qu’il s’agissait d’une question ayant été auparavant discutée et même codifiée, notamment dans la Déclaration de Bruxelles de 1874.Footnote 101 Reprise dans la Troisième Convention de Genève de 1949 (CGIII) afin d’attribuer le statut de prisonnier de guerre aux individus y prenant part, la levée en masse se définit comme suit: “[L]a population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières.”Footnote 102 Cet octroi du privilège du combattant aux civils prenant part à une levée en masse fut initialement portée par de petits États. Comme le souligne Eyal Benvenisti, à partir de la Conférence de Bruxelles de 1874, certains États s’identifièrent comme de potentiels occupés, tandis que d’autres s’identifièrent comme de potentiels occupants.Footnote 103 De ce point de vue, l’octroi des droits, devoirs, privilèges et statuts du DIH uniquement aux armées régulières était perçu comme étant nettement à l’avantage des grandes puissances militaires.Footnote 104 Autrement dit, la légitimité du statut, bien que fondée sur l’égalité formelle entre États belligérants — d’où l’égalité des belligérants — tendait sans grande surprise à favoriser les plus puissants d’entre eux. Ce biais particulier découlant de la légitimité du statut put toutefois être surmonté en mettant l’accent sur la qualité patriotique de la levée en masse.Footnote 105
En prenant les armes “spontanément” sans représenter formellement le souverain, le civil participant à une levée en masse voit dès lors la cause de son combat, le patriotisme, la résistance contre un ennemi extérieur, lui assurer une pleine inclusion au sein du DIH. L’élément de spontanéité est ici fondamental car il permet de disjoindre la levée en masse de toute forme de violence organisée, contrôlée et même sanctionnée en amont par l’État.Footnote 106 La condition de spontanéité implique donc que la décision de recourir à la violence “doit émaner du peuple et non des autorités” pour être qualifiée de levée en masse.Footnote 107 Geoffrey Best présente quant à lui la levée en masse comme “le droit du citoyen de participer spontanément à la défense de son pays,” disjoignant encore davantage cette dernière de l’État en invoquant un droit individuel ne nécessitant pas l’accord ou la sanction étatique.Footnote 108 En cela, les individus prenant part à une levée en masse constituent “une catégorie unique, car c’est le seul groupe de personnes reconnu par [la CGIII] qui jouit d’une autonomie totale par rapport à l’État.”Footnote 109 Et pour cause, les droits, devoirs, privilèges et le statut dont les entoure le DIH ne découlent pas de la légitimité du statut, centrée sur la qualité étatique, mais de la raison particulière motivant le recours à la force d’une partie de la population.
Si le patriotisme s’aligne objectivement avec les intérêts de l’État et de sa survie, c’est toutefois de la valeur de cette cause particulière et du choix de résister à une invasion étrangère dont découle l’octroi du privilège du combattant, et non pas la qualité étatique des individus prenant part à la levée en masse. Cette ambivalence d’un recours à la force n’émanant pas de l’État, mais dont l’objectif s’aligne avec ceux de ce dernier, dénote de la limitation temporelle de la levée en masse qui exclue toute application dans le long terme.Footnote 110 Derrière cette limitation se trouve l’idée que les individus prenant part à une levée en masse “doivent soit être remplacés par les forces armées régulières de leur État, soit s’y intégrer formellement” ou former des milices ou corps de volontaires reconnues par l’État une fois la période d’invasion terminée.Footnote 111 Gerry Simpson note très justement à ce sujet que le DIH veut simultanément “célébrer (en offrant un statut protégé) et annuler (en exigeant une assimilation rapide) ce moment de résistance.”Footnote 112 Il n’en demeure que la levée en masse, certes pour un cours laps de temps en DIH, créee “la possibilité d’une politique de résistance sans ou en dehors de l’État.”Footnote 113 Dans ce cours laps de temps, c’est aussi la légitimité du statut, et tout son imaginaire de guerre normativement idéale menée par des armées régulières, hiérarchisées et organisées, qui s’effacent. Dans cet interstice, c’est la cause motivant le recours à la force d’une partie de la population—la résistance à un ennemi extérieur—qui détermine l’application du DIH.
C’est toutefois le PAI et la catégorie des GLN qui opèrent le déplacement le plus visible de la légitimité du statut vers la légitimité de la cause. Comme déjà évoqué précédemment, les situations dans lesquelles “les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes” sont dans le cadre du PAI considéré comme des CAI et non plus comme des CANI.Footnote 114 Dans ce cas précis, il est difficile de nier que les causes même de la guerre exercent une influence majeure sur la nature des règles de DIH applicables. Ici, cette cause dont la légitimité est reconnue ne va pas jusqu’à placer les différentes parties d’un tel conflit dans une situation d’inégalité juridique. Elle implique toutefois une différence dans l’attribution de droits, devoirs et privilèges – principalement à travers l’attribution du statut de prisonnier de guerre aux combattants des mouvements de libération nationale – entre groupes non-étatiques dépendamment des causes défendues par ces derniers. En effet, l’entorse au principe de l’égalité des belligérants consacrée par la catégorie de CANI est ici abandonnée, élevant au contraire un type de groupe armé particulier, les mouvements de libération nationale, au même plan juridique que les États du point de vue des droits, devoirs et privilèges du DIH.
Comme nous y invite Georges Abi-Saab, représentant de l’Égypte et acteur majeur lors des négociations du PAI, il convient toutefois de replacer les efforts menés pour internationaliser les GLN en DIH dans un contexte plus large. Ces efforts diplomatiques, sous l’égide du CICR, s’inscrivaient dans une séquence plus longue de résolutions de l’Assemblée Générale des Nations-Unies (AGNU) visant à internationaliser et à qualifier les situations de domination coloniale et étrangère de “déni d’autodétermination.”Footnote 115 La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations-Unies de 1970 constitue certainement l’exemple le plus marquant de cette volonté de considérer le droit à l’autodétermination au-delà d’une simple métaphore.Footnote 116 La déclaration portait notamment sur les conséquences juridiques du “recours à la force dans le contexte de déni d’autodétermination.”Footnote 117 Bien que prudente dans sa formulation, la déclaration considéra que “tout État [avait] le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition [y compris la force] qui priverait les peuples […] de leur droit à disposer d’eux-mêmes.”Footnote 118 En revanche, les peuples subissant une telle domination, lorsqu’ils résistaient et exerçaient leur droit à l’autodétermination étaient en “droit de chercher et de recevoir un appui.”Footnote 119 En outre, et afin d’éviter toute relégation de la question de la domination coloniale et étrangère à une affaire purement interne et domestique, il fut ajouté que “le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome [possédait], en vertu de la Charte, un statut séparé́ et distinct de celui du territoire de l’État qui l’administre.”Footnote 120
En 1973, soit moins d’un an avant le début de la Conférence diplomatique qui allait s’étendre jusqu’en 1977, l’AGNU poussa la logique plus en avant. Dans la résolution 3103, l’Assemblée reconnut non seulement que “la lutte des peuples soumis à la domination coloniale et étrangère et à des régimes racistes pour la réalisation de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance [était] légitime et conforme aux principes du droit international,” mais que ces luttes devaient aussi être considérées comme des CAI, assurant ainsi aux combattants des mouvements de libération nationale le statut de prisonnier de guerre.Footnote 121 La logique était donc double, l’élévation des GLN en tant que CAI en DIH s’accompagnant également d’un effort visant à reconnaitre ces luttes comme non seulement légitimes, mais aussi licites du point de vue du recours à la force en les rattachant à l’exercice du droit à l’autodétermination.
Cette volonté d’intégrer formellement dans un traité des logiques et principes ayant été consolidés à travers la pratique de l’AGNU fut au cœur de l’argumentaire des défenseurs de ce qui allait devenir l’article 1(4).Footnote 122 Cette généalogie fut d’ailleurs utilisée par les États s’opposant à l’article 1(4) pour délégitimer ce projet d’internationalisation des GLN. Le délégué de la France avança ainsi:
Les activités de l’ONU et du CICR se situent à deux niveaux entièrement différents. L’ONU est une entité politique qui a pour rôle de trouver des solutions politiques aux problèmes spécifiques du moment, tandis que le DIH doit assurer en tous temps la protection de toutes les victimes de la guerre et ne saurait être dominé par des considérations subjectives quelles qu’elles soient. Tenir compte d’éléments comme les motivations, la justice, la légitimité est tout à fait normal à l’ONU mais ce genre d’exercice serait fatal à une assemblée qui se tient sous les auspices de la Croix-Rouge. Il n’y a pas de place dans le DIH pour des motivations ou des jugements subjectifs. Footnote 123
Se faisant la voix de l’objectivitéFootnote 124 face à cette inadmissible pénétration de la subjectivité dans la détermination de l’application du DIH, Antonio Cassese, alors représentant de l’Italie, considéra quant à lui que les GLN appartenaient, “à en juger objectivement,” à la catégorie des conflits internes.Footnote 125 Cet argument qui se voulait objectif, comme est supposé l’être la qualification juridique des CANI, se basait néanmoins sur l’argument colonial de l’indifférenciation entre territoires coloniaux et métropolitains. Dans un même esprit “d’objectivité,” Jean Pictet s’inquiéta du risque de rapprocher jus in bello et jus ad bellum:
[À] qualifier une catégorie particulière de conflits en fonction de critères subjectifs qui font appel aux causes de ces conflits et aux buts poursuivis par les parties […] on quitte le terrain du jus in bello pour s’engager sur un terrain étranger aux travaux de la Conférence, celui du jus ad bellum. [Il] serait extrêmement dangereux et contraire à l’esprit du DIH de qualifier les conflits armés en fonction de critères non objectifs et non juridiques, [la] Conférence ayant pour tâche d’accorder aux victimes de ces conflits la protection la plus étendue possible.Footnote 126
En se faisant la voix de “l’humanitaire” face aux “motivations politiques,” Pictet représente assez bien une certaine rhétorique déployée par de nombreux représentants occidentaux. À cela, Georges Abi-Saab se demanda ironiquement “si le fait d’ignorer sciemment l’une des principales formes de conflit armé de l’après-guerre était moins politique et plus humanitaire que de les prévoir explicitement.”Footnote 127 De la même manière, le fait que les guerres coloniales n’avaient pas de statut en droit international et n’existaient théoriquement pas à ses yeux était en lui-même une “construction juridique” charriant d’évidentes motivations politiques.Footnote 128 Étrangement, cette déclaration laisse également à penser que le DIH serait fondé sur des critères objectifs et juridiques, au contraire du jus ad bellum qui s’accommoderait de critères non-objectifs et non-juridiques. Au final, la critique de Pictet éclaire d’une certaine manière le projet poursuivi à travers l’article 1(4). En incluant des critères faisant appel aux causes des conflits et aux buts poursuivis par les parties comme éléments déterminants de l’application du DIH, le but fut finalement de donner un caractère juridique, à l’aide d’un traité international, à des critères que Pictet qualifiait quant à lui de non-objectifs.
Malgré ces oppositions, l’article 1(4) en tant que fusion de deux propositions issues des blocs non-aligné et socialiste fut adopté.Footnote 129 Le changement de conception de la légitimité est ici total et davantage visible que dans le cas de la levée en masse. Les membres de groupes luttant contre la “domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes” n’ont ainsi pas obtenu le privilège du combattant parce qu’ils représentaient une organisation politique particulière dont la légitimité eut été reconnue en amont — l’État — mais parce qu’ils se battaient pour une cause dont la légitimité fut reconnue en amont. Le PAI n’a évidemment pas étendu cette logique jusqu’à retirer aux membres des forces armées des puissances colonisatrices et occupantes ou des régimes racistes le privilège du combattant. Ceci fut d’ailleurs mobilisé pour contrer l’accusation selon laquelle l’article 1(4) constituait un retour à la notion de guerre juste en faisant coïncider jus in bello et jus ad bellum, en insistant sur le fait qu’aucune inégalité de traitement ne fut instaurée.Footnote 130 Pour autant, le PAI est malgré tout porteur d’un discours sur la légitimité de différentes formes de guerre.
Si la notion de guerre juste fut majoritairement mobilisée comme un outil rhétorique infamant visant à décrédibiliser le futur article 1(4), on peut toutefois s’extraire de cette conception et considérer a posteriori la notion comme ayant une réelle valeur heuristique. Comme l’avance Jessica Whyte, bien que les références explicites furent absentes, on peut considérer que “les anticolonialistes utilisèrent le langage de la guerre juste pour légitimer les luttes anticoloniales violentes.”Footnote 131 Comme ce fut le cas pour de nombreuses résolutions de l’AGNU, un certain univers de la guerre juste permit de “distinguer les guerres de libération nationale des ‘guerres d’agression impérialiste’.”Footnote 132 Cette distinction entre guerres justes et injustes, légitimes et illégitimes si l’on préfère, dépasse malgré tout l’unique problématique de l’extension du statut de prisonniers de guerre ou d’autres droits ou devoirs du DIH à des situations particulières. Alors que les efforts menés à l’AGNU n’ont jamais permis la reconnaissance “explicite d’un jus ad bellum aux mouvements de libération nationale,”Footnote 133 le DIH, à travers le PAI, autorise implicitement un tel recours à la force et performe une fonction de jus ad bellum. Par l’intermédiaire du DIH, le droit international prend, certes avec précaution, le parti des “peuples luttant contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes.” En accordant aux membres des mouvements de libération nationale le privilège du combattant, le DIH assure à ces derniers, en théorie, une protection contre de potentielles poursuites pénales. Par là même, le DIH retire aux puissances colonisatrices et occupantes ou aux régimes racistes la possibilité de considérer ces combattants comme des criminels – ce qu’il leur permet pourtant dans le cadre des CANI. Dans un geste très fanonien, on pourrait finalement soutenir que le DIH à la fois prend note de la violence structurelle du colonialisme, tout en légitimant la “contre-violence du colonisé,”Footnote 134 nécessaire à la liquidation de formes de pouvoir injustes fondées sur le colonialisme, l’occupation étrangère ou encore le racisme.Footnote 135
4. Égalité des belligérants et légitimité de la cause: la possibilité d’une exception?
Inséparable des questions de légitimité, le DIH ne peut donc se distancer totalement des causes de la guerre et des motivations des parties. C’est pourtant sur une totale séparation entre le DIH et de telles questions de légitimité que le communiqué d’Amnesty International, mais aussi le rapport du panel d’experts, se sont fondés. La première conclusion du rapport affirme ainsi que le DIH s’applique de manière réciproque à toutes les parties du conflit.Footnote 136 Bien que le rapport reconnaisse que l’Ukraine soit “clairement la victime d’une agression,” il est avancé que cela ne pourrait justifier que l’Ukraine s’écarte d’un strict respect du DIH.Footnote 137 En se basant sur le principe bien établi de l’égalité des belligérants, le rapport entend ainsi tenir à l’écart toute critique se fondant sur la légitimité de la résistance Ukrainienne. Ce principe de l’égalité des belligérants implique, comme le rappelle le rapport, que le DIH lie “d’une manière égale toutes les Parties au conflit.”Footnote 138 En érigeant ce principe comme pierre angulaire du régime,Footnote 139 il est également à nouveau affirmé que le DIH est — et surtout se doit d’être — aveugle aux causes de la guerre et aux motivations des parties.Footnote 140
Il sera toutefois défendu que la remise en cause d’un principe aussi central que celui de l’égalité des belligérants, s’il demeure controversé et potentiellement délétère, ne saurait être rejeté comme argument non-juridique ou étranger aux logiques du DIH. Cela implique néanmoins de se défaire, comme tente de le faire le présent article, des postulats positivistes envisageant le droit international comme un ensemble de règles et principes auxquelles sont associés une interprétation relativement stable.Footnote 141
A. Prendre l’indétermination du droit international au sérieux
Loin d’être “un ensemble de règles régissant les relations entre les États,” le droit international se présente davantage comme “une profession, une discipline, dans laquelle [sont poursuivis des projets] dans un vocabulaire partagé, à travers l’appareil de pratiques et d’institutions professionnelles partagées.”Footnote 142 La principale conséquence de la poursuite de projets souvent concurrents et contradictoires à travers le langage du droit international est l’indétermination de ce dernier. Plus qu’une simple indétermination linguistique que les positivistes ont depuis longtemps identifiée,Footnote 143 cette indétermination est davantage structurelle et constitue une caractéristique déterminante du langage du droit international. De la reconnaissance de cette indétermination découle le refus de considérer que certaines règles, certains principes, ou une certaine interprétation de ces derniers, constituent l’unique réponse valide à un problème juridique donné. L’aspect central de l’indétermination est ainsi d’avancer que même les arguments fondés sur les règles ou principes les mieux établis peuvent se voir opposer une autre règle ou un contre principe. Comme l’avance Koskenniemi, “il est possible de défendre n’importe quelle ligne de conduite — y compris une dérogation à une règle claire — par des arguments juridiques professionnels impeccables qui vont des règles à leurs raisons sous-jacentes [ou qui opèrent] des choix entre plusieurs règles ainsi qu’entre des règles et des exceptions.”Footnote 144
Les deux modes d’argumentation descendant et ascendant identifiés par Koskenniemi et qui permettent cette oscillation, sont donc simultanément valides tout en étant “vulnérables aux critiques de leur opposé.”Footnote 145 Cela n’implique pas pour autant que le droit international n’ait pas de substance et que la formulation de n’importe quel argument soit possible. Il s’agit comme le relève Justin Desautels-Stein d’une “indétermination structurée” dans laquelle le libre jeu des arguments opposés opère sous la contrainte de la grammaire binaire des modes argumentatifs ascendants et descendants.Footnote 146 En DIH, cette grammaire binaire prend bien souvent la forme de l’opposition entres deux modes argumentatifs fondés sur la légitimité du statut pour l’un, sur la légitimité de la cause pour l’autre. Comme l’adoption de l’article 1(4) du PAI l’illustre, les arguments utilisés pour défendre ou attaquer l’inclusion de critères liés à la cause de la guerre ou aux motivations des parties peuvent se comprendre selon cette taxonomie. Mais cette dynamique de contradiction particulière rend ultimement impossible la séparation totale entre jus in bello et jus ad bellum. Dans les deux modes argumentatifs, le renvoi au jus ad bellum est en effet omniprésent. Dans le premier cas, il permet explicitement ou implicitement de justifier l’inclusion d’éléments permettant d’aller au-delà du formalisme de légitimité du statut. À l’inverse, le jus ad bellum est aussi constamment mobilisé comme contre-modèle, permettant bien souvent de soutenir le statu quo. Or, le jus ad bellum joue ici un rôle non-moins déterminant en permettant de soutenir une interprétation particulière de l’identité et de la raison d’être du DIH. En cela, l’omniprésence du jus ad bellum est nécessaire et permet la construction d’une interprétation du DIH a contrario.
Peut-on dès lors formuler un argument juridique valide à travers lequel il serait envisagé une dérogation ou une exception à un principe qui semble aussi établi que celui de l’égalité des belligérants ? Peut-on encore articuler cette exception à l’aide de la cause particulière d’une des parties ? D’un point de vue purement théorique, rien dans la structure du droit international n’empêche cette possibilité, bien au contraire. Comme l’indique Pierre Schlag dans le contexte domestique, “le droit dépasse ce qu’un juge appellera le droit en fin de compte” et ce dernier “substituera au droit l’une de ses possibilités.”Footnote 147 Il en va de même au sein du droit international où une certaine interprétation sanctionnée comme valide par une institution, la doctrine, une juge ou tout autre acteur, dissimule une ou plusieurs autres possibilités également valides. Néanmoins, faire émerger ces multiples possibilités n’implique pas une réflexion abstraite. La coexistence d’arguments juridiques concurrents et contradictoires “disciplinairement valides” est le fruit de la “culture intellectuelle du droit international.”Footnote 148 Le droit international étant un “champ discursif,” ce dernier ne peut exister “séparément de la profession juridique,”Footnote 149 dont la caractéristique est d’être composée d’acteurs différents poursuivant divers projets. Il convient dès lors de déterminer s’il a pu exister, dans la culture intellectuelle du droit international, des arguments juridiques se fondant sur une remise en cause du principe de l’égalité des belligérants.
B. Contester le principe de l’égalité des belligérants: des négociations des Conventions de Genève à la Cour international de Justice
L’objectif n’est pas ici de soutenir l’idée que l’égalité des belligérants serait un principe à dépasser. Il est en revanche avancé que certains arguments visant à remettre en cause ce principe, loin d’être des aberrations juridiques, constituent des arguments juridiques valides ayant trouvé leur expression au sein même de la discipline du droit international. Par là même, l’histoire du droit international n’est pas uniquement, ni même principalement, un récit désintéressé du passé de la discipline à travers laquelle on tracerait la généalogie d’une règle particulière ou de ce qui a pu devenir l’interprétation dominante concernant un problème juridique donné. Le travail généalogique implique davantage de mettre en lumière ce qui aurait pu être différent, les chemins alternatifs ayant été envisagés,Footnote 150 et ce qui finalement demeure présent comme alternative.
Comme avancé précédemment, l’oscillation du DIH entre légitimité du statut et légitimité de la cause a toujours impliqué une forte préoccupation du régime pour les questions relatives aux causes de la guerre et aux motivations des parties. Rien dans l’histoire et dans les logiques du DIH n’exclut alors de manière absolue les causes de la guerre ou les questions de légitimité comme éléments pertinents concernant l’application du régime. Toutefois, qu’il s’agisse de la levée en masse ou des GLN, la prise en considération de la cause de la guerre et des motivations des parties n’est pas allée jusqu’à reconnaitre la supériorité juridique d’une partie au dépend d’une autre, venant ainsi entériner une application à géométrie variable du DIH. Dans ces deux cas, la prise en considération de la cause du recours à la violence aboutit à un changement de nature des droits, devoirs ou privilèges applicables à une partie, sans pour autant créer une asymétrie juridique avec la partie ennemie. Cette asymétrie juridique est en revanche, comme abordé précédemment, un élément central du régime des CANI.
Pourtant, et comme l’a bien montré Boyd Van Dijk, ce principe de l’égalité des belligérants fut frontalement attaqué lors des négociations des Conventions de Genève de 1949.Footnote 151 Une proposition danoise, soutenue notamment par les délégations soviétique et française, mit par exemple l’accent sur la situation des civils dans le cas d’une guerre d’agression ou d’une occupation illégale. Selon le délégué danois, “la guerre d’agression ayant été déclarée par les États à l’unanimité́, crime international, il va sans dire que, dans un tel cas, la résistance de la population civile doit être considérée comme un acte de légitime défense.”Footnote 152 La proposition fut néanmoins attaquée par la délégation britannique qui estimait qu’il s’agissait là d’une approche “ternissant la notion que le jus in bello est basé sur l’égalité des belligérants.”Footnote 153 En revanche, le délégué israélien, en faisant référence au génocide dont avaient été victimes les populations juives, mit également de l’avant qu’il était impossible de mettre de côté les causes de la guerre: “Que doit faire un peuple dans de telles circonstances ? Ne doit-il pas chercher à se défendre, comme c’est son droit et même son devoir ?”Footnote 154 Ici, une référence à une nécessité supérieure, empruntant bien plus volontiers à une conception jusnaturaliste du droit qu’à une approche positiviste, fut considérée comme pouvant mener à une déviation de ce qui était pourtant admis comme une règle claire et bien établie. Comme l’avance Van Dijk, de nombreux acteurs reconnaissaient que le strict principe de l’égalité des belligérants avait “perdu de sa pertinence à l’ère du génocide.”Footnote 155 Plus généralement, la proposition danoise et la logique sous-tendant celle-ci affirmaient que “ce principe devrait être assoupli, notamment pour les civils armés agissant en légitime défense contre des actes d’agression ou de génocide.”Footnote 156 La légitimité de la résistance face à une guerre d’agression était alors perçue comme un élément devant influencer l’application de certains aspects du DIH.
Loin d’être marginales, ces remises en cause du principe de l’égalité des belligérants sont des produits de la logique même du DIH et de son oscillation entre légitimité du statut et légitimité de la cause. S’il est évident que l’argument de l’égalité des belligérants est juridiquement fondé, ce serait toutefois passer sous silence les contradictions du DIH que d’estimer que la contestation de ce principe ne mériterait pas la même reconnaissance. Il ne s’agit pas d’affirmer que cette contestation ne serait pas hautement controversée et qu’elle ne serait pas potentiellement dangereuse. Les développements précédents concernant la levée en masse, les GLN et le développement d’un discours juridique remettant en cause l’égalité des belligérants ont avant tout tenté de mettre en lumière le fait que le DIH a été depuis l’origine l’objet de nombreuses contestations et luttes, notamment pour inclure les causes de la guerre et les motivations des parties comme critères déterminant l’application du régime. Que cela ait mené ou non à des changements dans le droit positif est ici relativement secondaire. Le propre d’une approche critique du droit international considérant ce dernier comme une “formation discursive,”Footnote 157 implique en effet que soit abandonnée l’idée qu’il existerait une “distinction fondamentale entre des règles, des doctrines et des concepts.”Footnote 158
L’égalité des belligérants, découlant directement de la légitimité du statut et de la vision étatiste du DIH, a donc logiquement souffert des efforts tendant à inclure des notions dites de jus ad bellum dans le domaine du jus in bello. Tous ces efforts, qu’ils aient amené des changements dans le droit positif comme dans le cas de la levée en masse ou des GLN, ou qu’ils aient permis le développement d’une pratique argumentative particulière, ont tous tenté de faire pencher la balance du DIH vers une conception de légitimité fondée sur la cause. Dans le cas de l’Ukraine ou d’autres cas similaires, il n’est donc pas aberrant d’un point de vue juridique, et non pas seulement moral ou politique, d’avancer que la cause, ici la résistance ukrainienne à un acte d’agression, pourrait justifier certains actes qui s’avèreraient contraire au DIH, ou du moins pencher pour une application différenciée de certains aspects de ce dernier. Si les négociations des Conventions de Genève n’ont finalement pas abouti à l’adoption d’une mesure prévoyant certaines dérogations au principe de l’égalité des belligérants, cela n’implique pas pour autant que cet échec diplomatique équivaut à une expulsion de cette approche hors de toute rationalité juridique. Cet argument controversé fait par ailleurs écho à un aspect non moins controversé de l’avis consultatif de la CIJ sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires dans lequel le principe de l’égalité des belligérants fut implicitement considéré comme pouvant faire l’objet d’une exception. Alors que la Cour semblait en effet affirmer que par leur nature “l’utilisation [des armes nucléaires n’apparaissait] effectivement guère conciliable” avec les principes du DIH, une majorité des juges ne put toutefois exclure qu’une exception puisse justifier leur utilisation:
Il ressort des exigences susmentionnées que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire; Au vu de l’état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause.Footnote 159
Dans ce cas précis, il fut ainsi envisagé que le recours à une méthode de combat de prime abord illicite au regard du DIH, pourrait se voir justifié par une cause supérieure — la survie de l’État. Il est ici aisé de tracer un parallèle avec la situation ukrainienne. Luttant dans le cadre d’une guerre asymétrique une invasion et une occupation illégales de son territoire, il peut être aisément avancé que la survie de l’État ukrainien, du moins durant une certaine période, fut menacée.Footnote 160 Dans ce contexte, si les allégations d’Amnesty International sont par ailleurs contestables, l’installation de “bases militaires […] dans des zones résidentielles” ou encore le fait de lancer des attaques “depuis des secteurs habités par des civil·e·s”Footnote 161 peuvent se voir juridiquement justifiées par la légitimité de la cause ukrainienne — une “circonstance extrême de légitime défense” dans le langage de la CIJ.
Ce point controversé de la décision de la CIJ semble toutefois s’inscrire dans un phénomène courant de brouillage des frontières entre jus in bello et jus ad bellum dans les situations de légitime défense. Cela se matérialise notamment par une tendance dans la pratique à confondreFootnote 162 ou encore à fusionner les notions de proportionnalité du jus in bello et du jus ad bellum. Footnote 163 Amalgamer la proportionnalité du jus in bello avec “la proportionnalité du jus ad bellum, et la nécessité de donner à l’État attaqué le pouvoir nécessaire pour répondre à l’agression, a [ainsi] pour effet d’élargir sa discrétion dans la détermination de l’avantage escompté de l’action militaire.”Footnote 164 Cette interprétation se rapproche nettement de la logique de la décision de la CIJ lorsqu’il est envisagé un dépassement de l’égalité des belligérants.Footnote 165 Sous l’influence du jus ad bellum, l’obligation de proportionnalité en DIH serait ainsi moins stricte pour la partie agressée que pour l’agresseur:
[Traduction] [Cette approche] tend à mettre en évidence l’impact du jus ad bellum, un régime juridique profondément asymétrique établissant une hiérarchie claire entre les belligérants, sur le régime juridique égalitaire du jus in bello. Cette perspective repose sur le principe selon lequel la nécessité de repousser l’attaque représente le critère essentiel à l’aune duquel la légalité de toute action militaire doit être évaluée. Si le seul moyen de repousser l’attaque consiste à utiliser des moyens ou des méthodes entraînant un nombre élevé de victimes, cela devrait néanmoins être acceptable car la seule alternative serait la défaite.Footnote 166
Cela démontre encore une fois que des situations extrêmes telles que la légitime défense, la subjugation coloniale, ou encore l’invasion étrangère ébranlent les certitudes quant à la nécessité d’une stricte séparation du jus ad bellum et du jus in bello.
Bien que les arguments ci-dessus semblent aller dans le sens d’une plus grande sensibilité accordée aux victimes de guerres d’agression, de telles logiques, à l’instar de nombreuses logiques du droit international, pourraient très facilement “revenir hanter” ces mêmes victimes dans un autre contexte.Footnote 167 Il y a même fort à parier que le potentiel délétère de ces arguments outrepasse largement leurs potentiels effets positifs. Toutefois, en rejetant ces derniers hors de toute rationalité juridique au motif qu’ils procéderaient d’un brouillage de la distinction jus in bello/jus ad bellum et d’une inclusion néfaste des causes de la guerre et des motivations des parties, on rejetterait également, comme ce fut le cas dans le passé, les arguments ayant, par exemple, permis l’adoption de l’article 1(4) du PAI. Ces arguments sont au contraire, dans leur grande variété et dans leurs aspects émancipateurs mais aussi oppressifs, l’émanation de la rationalité juridique particulière du DIH, de son évolution et de ses biais structurels. En ce sens, le présent article se voulait également une intervention plus large et allant à l’encontre d’une forme d’“herméneutique de la suspicion”Footnote 168 largement présente au sein du droit internationalFootnote 169 et à travers laquelle certains arguments, notamment contestataires, sont considérés comme faux et dénués de validité juridique car étant idéologiquement, politiquement ou encore moralement motivés — contrairement aux approches orthodoxes qui seraient uniquement fondées sur un raisonnement juridique libéré de tout biais.
***
Un des objectifs du présent article fut d’avancer que les tentatives visant à séparer hermétiquement le DIH des causes de la guerre et des motivations des parties, ou plus généralement de considérations de légitimité, sont à la fois vaines et à rebours de l’évolution et des logiques du régime. Par la même occasion, cette approche moins restrictive permet de se libérer d’un certain habitus disciplinaire au nom duquel certaines pratiques argumentatives se voient exclues du champ du DIH, sans que l’on ne s’interroge néanmoins sur les fondements d’une telle exclusion. Si le DIH conserve encore aujourd’hui une forme d’acceptation et qu’il demeure un outil pertinent, il le doit certainement davantage aux remises en cause de certains de ses dogmes par le passé que d’une attitude visant à l’entourer de principes indépassables.
En guise d’épilogue, un bref détour vers une des justifications invoquées par la Russie pour justifier son invasion de l’Ukraine permet d’illustrer à nouveau comment la discipline du DIH, mais aussi du droit international plus généralement, tendent à exclure des discours ou des concepts qui ont pourtant façonné ces dernières dans le passé. En invoquant l’argument de la “dénazification” pour justifier son invasion de l’Ukraine, la Russie s’est livrée à un exercice de propagande de guerre évident. Si le procédé peut sembler grossier, il y a malgré tout, comme l’avancent Anastasiya Kotova et Ntina Tzouvala, “une valeur analytique, politique et même doctrinale à lire les justifications juridiques russes de l’invasion non pas comme aberrantes ou anormales, mais comme faisant partie d’une gamme plus large d’utilisations impérialistes du droit international, passées et présentes.”Footnote 170 C’est d’ailleurs davantage sur son caractère impérialiste que cette justification devrait être rejetée, et non pas sur le fondement qu’elle ne soit pas juridique, ce qui laisserait à penser que rationalité juridique et impérialisme n’aient jamais entretenu une relation féconde. Dans le cas précis du DIH et du droit de l’occupation, le concept de dénazification apparait également avoir été choisi afin de contourner le “principe conservationniste” et semble annoncer des transformations “des lois en vigueur”Footnote 171 au-delà de ce que permet le droit de l’occupation.Footnote 172 Ici encore, le concept de dénazification ne saurait être exclu du champ de la rationalité juridique tant ce dernier a exercé une influence majeure sur l’évolution et l’interprétation du droit de l’occupation depuis la défaite de l’Allemagne nazie.Footnote 173
Pour conclure, reconnaitre que le DIH s’inscrit dans une “vision politique du monde disant quelque chose sur ce qu’est la violence légitime”Footnote 174 ne fragilise pas les fondements du régime. Au contraire, mettre en lumière les biais de ce dernier, ses contradictions ou les tensions qui le traversent permet notamment d’illustrer “les usages changeants du droit entre acteurs hégémoniques et non hégémoniques.”Footnote 175 Cela implique toutefois de remettre en question des catégories, des principes ou des doctrines qui ont été naturalisés au point où il n’est plus nécessaire d’en justifier le bien fondé. Cela implique de reconnaitre que “le droit n’est jamais une norme unique, mais [qu’]il est la norme et l’exception, le principe et le contre-principe, la justification et la critique des intérêts hégémoniques.”Footnote 176