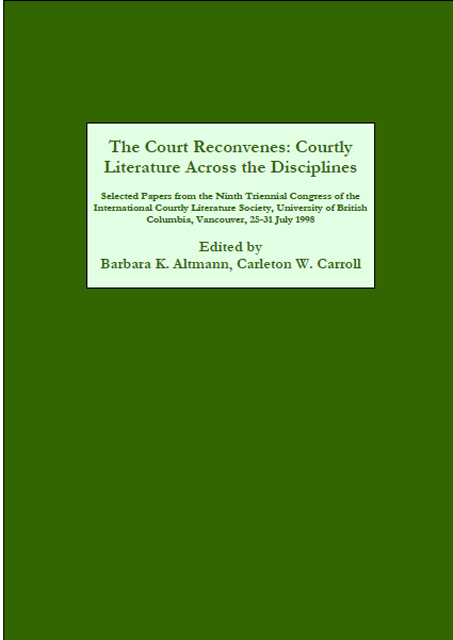 The Court Reconvenes
The Court Reconvenes Variations sur l’espace dans le lai du Chaitivel
Published online by Cambridge University Press: 31 March 2023
Summary
Que les Lais de Marie de France continuent à opérer leur charme sur celui qui les lit, semble être un fait indéniable. Tout aussi indéniable paraît le fait que les douze lais n’ont pas toujours exercé un même pouvoir de séduction, témoins les lais d’Equitan et de Chaitivel auxquels on a même refusé le titre de lai et qui se sont vus relégués dans le champ du fabliau (Harf 106–07). Des deux lais, celui du Chaitivel a été le moins prisé. On lui a reproché entre autres son manque de valeur littéraire, son style « embarrassé » (Tuffrau viii), ses faiblesses au niveau de la composition (Burgess 15). Nul ne conteste cependant la présence de traits, si superficiels soient-ils, le rattachant à l’esprit courtois (Ménard 133; Wind 741–42). Certains critiques ont vu le lai comme un débat posant un problème de casuistique courtoise (Hoepffner 161; Lazar 197); d’autres ont trouvé dans le De Amore d’André Le Chapelain un cas à débattre analogue à celui présenté dans le lai (Mickel 58; Baum 186). D’aucuns ont considéré le lai comme un « parfait exemple d’une authentique nouvelle courtoise » (Ménard 58) annonçant un genre fort en vogue au XIIIe siècle, notamment le lai courtois, ou comme « une nouvelle dépouillée … [dont] le message se réduit ici à un simple qualificatif revendiqué par l’amoureux, un blason » (Poirion 113). Le lai a également été rattaché à la lyrique occitane: le dialogue final serait une réminiscence sous forme narrative de la tenson des troubadours (Mora-Lebrun).
Dans un premier temps, la plupart des critiques ont vu la dame comme « la Belle Dame sans merci » et ont interprété son comportement, qu’ils qualifiaient d’altier, d’insensible, et de vaniteux, comme signe de la désapprobation de Marie de France sinon pour la doctrine de la fin’amors (Hoepffner 165; Green 266, 270), du moins pour quelques-uns de ses principes (Wind 743; Lazar 197). Aujourd’hui, la critique se montre plus clémente envers la dame et lui porte un jugement moins sévère, moins dur. Elle n’est plus traitée de « coquette orgueilleuse » ou de « belle inhumaine se refusant à l’amour » (Ménard 67; Sienaert 148–149; Harper et Verhuyck 188).
- Type
- Chapter
- Information
- The Court ReconvenesCourtly Literature across the Disciplines: Selected Papers from the Ninth Triennial Congress of the International Courtly Literature Society, University of British Columbia, Vancouver, 25-31 July 1998, pp. 215 - 222Publisher: Boydell & BrewerPrint publication year: 2002
