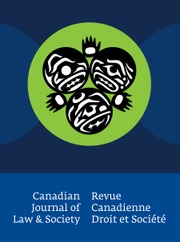Introduction
Dans son acception la plus simple, le concept de justice centrée sur la personne signifie tout simplement que la justice devrait être centrée sur la personne. Mais au-delà de cette tautologie, les contours précis du concept demeurent incertains, tout comme ses ramifications. Plusieurs questions normatives et pratiques se posent. Sur le plan normatif, la justice centrée sur la personne devrait-elle être le seul principe, ou même le principe cardinal, guidant les réformes de la justice? Sur le plan pratique, comment un service ou une institution peut-il être « centré », concrètement, sur la personne? Et sur ces deux fronts – normatif et pratique – la justice centrée sur la personne devrait-elle s’appliquer différemment à divers services, par exemple, le règlement des différends en comparaison avec l’information et les conseils juridiques?
Le présent article examine ces questions en mettant l’accent sur l’incidence de la justice centrée sur la personne sur le règlement des différends. À première vue, cet angle peut sembler antinomique. La plupart des textes qui traitent de la justice centrée sur la personne prônent une certaine distanciation des institutions formelles au profit d’une gamme de services de prévention et de résolution précoce des problèmes juridiquesFootnote 1. Ces services comprennent, par exemple, des services juridiques communautaires, des conseils de parajuristes, des bilans de santé juridiques et d’autres initiatives de première ligne. Cela dit, le concept de justice centrée sur la personne a une portée plus large et promet aussi de transformer le règlement des différendsFootnote 2. C’est pourquoi il est également utile d’examiner ses ramifications pour les institutions de règlement des différends, que ce soit celles de l’État ou d’autresFootnote 3.
Avant d’examiner ces ramifications, il faut dans un premier temps définir la justice centrée sur la personne. Bien que ce concept soit de plus en plus présent dans les débats autour de l’accès à la justice, il demeure mal défini. La première partie du présent article commence par tracer les principaux contours de la justice centrée sur la personne au moyen d’une analyse thématique réflexive de la littérature. Cet exercice révèle un écueil important qui surgit lorsque la justice centrée sur la personne est appliquée au règlement des différends : bien qu’elle poursuive des objectifs louables dans ce contexte (comme dans d’autres par ailleurs), ses acceptions courantes ne tiennent pas compte de la contribution des tribunaux au développement du droit dans les sociétés démocratiques. Le fait que cette fonction publique du règlement des différends soit absente du discours actuel sur la justice centrée sur la personne découle probablement de l’accent que celui-ci met sur les services juridiques axés sur les besoins privés. Or, la justice centrée sur la personne doit à notre avis tenir compte de cette fonction publique essentielle lorsqu’il s’agit de l’appliquer au règlement des différends.
Cette tension entre les fonctions publique et privée du règlement des différends n’est pas facile à résoudre en pratique, ce qui suscite une deuxième question : comment, concrètement, peut-on fournir des services de règlement des différends centrés sur la personne sans nuire à la fonction publique des tribunaux? Les réformes éventuelles peuvent chercher à centrer le processus des tribunaux existants autour de la personne, mais d’autres arrangements institutionnels peuvent aussi être envisagés. La deuxième partie du présent article illustre ce point en proposant que les tribunaux non professionnels – des institutions locales menées par des gens « ordinaires » sans aucune formation ni expérience en droit – pourraient offrir un règlement des différends qui soit centré sur la personne tout en préservant la fonction publique du système de justice. Bien que les tribunaux non professionnels ne soient pas le seul moyen d’atteindre cet objectif, ils constituent un exemple intéressant des types de réformes que la justice centrée sur la personne pourrait inspirer.
I. La justice centrée sur la personne
Le concept de justice centrée sur la personne échappe à une définition précise en raison de sa malléabilité et de son application potentielle à un large éventail de situationsFootnote 4. Pourtant, si l’on souhaite l’utiliser pour façonner les réformes de la justice, il faut d’abord le définir clairement et mieux comprendre ses ramifications. La plupart des auteurs et des organisations ont mis de l’avant des versions de la justice centrée sur la personne qui, malgré leurs différences, s’articulent autour de thèmes communs. La présente section tente de reconstruire ces thèmes au moyen d’une analyse thématique réflexive de la littérature (1) avant d’en faire une analyse critique dans le contexte du règlement des différends (2).
1. Thèmes et définition
La présente section a pour objet d’élaborer une définition plus précise de la justice centrée sur la personne en se fondant sur la littérature existante. Cet exercice est « constructionniste » en ce qu’il « s’intéresse à la création de sens » et « se concentre sur la construction sociale de la réalité »Footnote 5, cherchant en l’espèce à cerner de quelle façon la justice centrée sur la personne s’est construite dans divers contextes. Une méthodologie appropriée pour explorer ce type de question est l’analyse thématique réflexive, laquelle ne vise pas simplement à résumer un ensemble de thèmes trouvés dans la littérature, mais plutôt à construire de manière interprétative des « modèles de sens ancrés par une idée ou un concept partagé »Footnote 6. Les thèmes sont donc « produits par le chercheur grâce à son engagement analytique systématique avec l’ensemble des données »Footnote 7, en l’occurrence une collection complète de sources universitaires et autres traitant de justice centrée sur la personneFootnote 8.
Étant donné qu’une approche réflexive de l’analyse thématique s’ancre dans la perspective du chercheur, elle doit rendre explicites les postulats théoriques qui constituent le fondement de la rechercheFootnote 9. En l’espèce, l’analyse est guidée par la tension essentielle qui existe entre les fonctions privée et publique de notre système de justice. Ces deux fonctions font l’objet d’une abondante littérature développée principalement en réaction à divers efforts de privatisation de la justice, y compris l’importance croissante accordée aux transactions et au détournement des différends vers la médiation et l’arbitrage. Un bref compte rendu de ce corpus de littérature servira de fondement à l’analyse thématique qui suit.
Tout en reconnaissant les avantages que la privatisation des litiges peut procurer à certains justiciables, les auteurs mettent en garde contre les risques qu’elle comporte pour la justice publique. Fiss a fait valoir que le fait de détourner des affaires des tribunaux pourrait nuire à leur capacité de développer la common lawFootnote 10. Cette inquiétude reflète l’idée que la justice rend service non seulement à chaque personne – en résolvant ses différends – mais aussi à la communauté en précisant les normes qui nous gouvernent en société. Dans le même ordre d’idées, Genn soutient que « le système de justice civile est un bien public qui sert plus que les intérêts privés » puisque « les tribunaux civils contribuent discrètement et de manière significative au bien-être social et économique »; la privatisation, de ce point de vue, réduit la justice à un simple bien privéFootnote 11. D’autres auteurs, dont Resnik et Lahav, développent un argument similaire autour de l’idée de démocratie : dans les démocraties, les tribunaux publics offrent « des occasions de parité participative qui rendent possible un dialogue démocratique entre les parties au litige tout en leur imposant des contraintes »Footnote 12. En somme, bien que les tribunaux fournissent un service privé aux justiciables, ils jouent également un rôle public essentiel qui risque d’être perturbé lorsque des réformes leur retirent des dossiers. Une approche envers la justice qui se centre sur la personne peut soulever des inquiétudes à cet égard.
L’analyse thématique que déploie le présent article cherche à examiner cette tension de manière réflexive afin de construire les thèmes centraux autour desquels s’articulent les conceptions actuelles de la justice centrée sur la personne. Cette analyse permet de dégager six thèmes principaux, examinés plus en détail ci-après. Le premier est l’importance de recueillir des données probantes sur les besoins juridiques des justiciables. La nature de ces besoins, telle qu’identifiée dans des sondages récents, met en relief deux autres thèmes, à savoir l’importance que les services soient à la fois accessibles et suffisamment flexibles et interdisciplinaires pour répondre aux besoins des individus de manière holistique. Le quatrième thème est l’importance de l’autonomisation pour rendre ces efforts durables. Enfin, bien qu’une approche centrée sur la personne puisse inspirer le changement à différents niveaux, les quatre premiers thèmes encouragent naturellement les initiatives locales et communautaires, qui constituent les cinquième et sixième thèmes de la justice centrée sur la personne.
Avant d’explorer ces thèmes plus avant, il est utile de comprendre pourquoi la justice centrée sur la personne est apparue et quels sont les enjeux auxquels elle vise à répondre. Dans le domaine du développement international, les premières versions de la justice centrée sur la personne ont émergé en réaction aux programmes traditionnels des agences de coopération internationale en matière de primauté du droit. En 2008, la Commission sur la démarginalisation des pauvres par le droit a souligné que ces initiatives ne parvenaient souvent pas à fournir une justice durable et efficace aux populations locales parce qu’elles se concentraient presque exclusivement sur les institutions formellesFootnote 13. Le rapport de la Commission appelait à s’éloigner de ces structures pour s’orienter plutôt vers des résultats mesurables reflétant l’expérience des justiciablesFootnote 14. Bien que le rapport ne faisait pas expressément référence à la justice centrée sur la personne, il a semé les germes à partir desquels le concept s’est développé.
Depuis lors, la justice centrée sur la personne a été largement adoptée sur le plan internationalFootnote 15. De nombreuses organisations ont recours à ce concept pour appeler à des réformes qui non seulement répondent aux besoins juridiques insatisfaitsFootnote 16, mais le font d’une manière qui « renforce les liens en société, permet aux démocraties de répondre aux attentes des individus, et […] rétablit la confiance entre les individus et les gouvernements »Footnote 17. En visant à fournir des services juridiques qui sont non seulement rapides et efficaces, mais aussi fiables et autonomisants, une approche centrée sur la personne s’efforce de rendre justice de manière plus durable et plus efficace. La question qui se pose alors est de savoir comment une approche centrée sur la personne est mieux placée que les interventions traditionnelles pour atteindre ces objectifs. C’est là que les thèmes mentionnés en introduction entrent en jeu. Ces thèmes sont construits à partir de la littérature, dont une bonne partie s’articule autour du Cadre pour une justice centrée sur les personnes publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2021Footnote 18.
Le premier pilier de ce cadre – « concevoir des réponses en matière de justice fondées sur une compréhension empirique des besoins des personnes en matière de droit et de justice »Footnote 19 – constitue le premier thème clé de la justice centrée sur la personne, à savoir l’importance de recueillir et de s’appuyer sur des données probantes concernant les besoins juridiques de la population et son expérience avec les institutions judiciaires. Bien que la recherche empirique sur l’accès à la justice ait gagné en importance au cours des dernières décennies, elle s’est principalement attardée à des programmes et des réformes particulièresFootnote 20. Selon Sandefur et Burnett, une démarche centrée sur la personne implique l’évaluation de l’accès à la justice au moyen de données qui ne portent pas principalement sur de telles institutions, mais plutôt sur leur « incidence sur les expériences des gens ordinaires »Footnote 21. Ces expériences se reflètent non seulement dans les mesures traditionnelles relatives aux coûts et aux retards, mais aussi à travers des indicateurs relatifs « aux circonstances et aux émotions – comment les gens vivent des problèmes reliés au droit et à la justice, et comment ils s’engagent dans les voies disponibles pour les résoudre »Footnote 22.
L’accent que met la justice centrée sur la personne sur les données probantes relatives aux besoins et aux expériences des justiciables donne lieu aux autres thèmes qui caractérisent ce concept. Étant donné que la recherche indique que les besoins juridiques demeurent largement insatisfaits, le deuxième thème qui sous-tend le concept est l’accessibilité des services juridiques. Au Canada, par exemple, des études ont montré que près de la moitié de la population adulte connaîtra au moins un problème juridique grave sur une période de trois ans et que, même si 95 % de ces personnes tentent de résoudre leur problème, environ 75 % le feront par des voies informelles, qu’il s’agisse par exemple d’assistance non juridique, de recherches sur Internet, de communications directes avec l’autre partie, ou de consultations auprès d’amis et de membres de la familleFootnote 23. Pour remédier à cette situation, la justice centrée sur la personne vise à rendre accessible à tous un large éventail de services formels et informelsFootnote 24.
Des études empiriques ont également révélé que les problèmes juridiques sont étroitement liés à divers enjeux en rapport avec, par exemple, les programmes sociaux, la santé, l’emploi, l’éducation et les ressources financièresFootnote 25. Conformément à l’accent qu’elle met sur les données probantes, la justice centrée sur la personne répond à cette observation par le biais de deux autres thèmes. Premièrement, elle accorde la priorité aux interventions qui s’attaquent non seulement aux dimensions juridiques des problèmes des justiciables, mais aussi à leurs causes profondes et à leurs autres conséquences, « en prévenant l’apparition de problèmes plus importants et en les résolvant au fur et à mesure qu’ils se présentent »Footnote 26. Autrement dit, les services centrés sur la personne s’efforcent d’être « l’expression d’une justice holistique et intégrée »Footnote 27. Dans plusieurs cas, cela demande une réponse interdisciplinaire impliquant des acteurs de différents secteurs. Ce type de réponse est particulièrement important compte tenu de l’incapacité de nombreuses personnes à reconnaître les conséquences juridiques des problèmes auxquels elles sont confrontées. La mise en place de structures interdisciplinaires au sein desquelles des services juridiques et non juridiques sont fournis simultanément augmente la probabilité de rejoindre des personnes qui, sans nécessairement reconnaître les dimensions juridiques de leurs problèmes, sollicitent intuitivement l’aide d’autres prestataires de services auxquels elles font confiance, par exemple les travailleurs de la santé.
Le quatrième thème, étroitement lié à l’interdisciplinarité, est l’idée que les services juridiques devraient être suffisamment flexibles pour s’adapter aux besoins variés des individus. Alors que les institutions formelles – en particulier celles de l’État – adoptent souvent une approche unique, les « services [centrés sur la personne] devraient être adaptés pour répondre aux besoins diversifiés de différents groupes »Footnote 28. Différentes populations peuvent ne pas avoir les mêmes besoins ni la même expérience en matière de services juridiques, et peuvent donc requérir des interventions différentesFootnote 29. Cela signifie que « les services de justice centrés sur la personne sont ceux qui sont les plus appropriés pour que la personne en question s’attaque au problème ou aux problèmes auxquels elle est confrontée dans sa situation particulière, et qui sont à la fois durables et efficaces sur le plan économique »Footnote 30.
Cette référence à l’efficacité économique et à la durabilité renvoie aux trois derniers thèmes de la justice centrée sur la personne, qui visent à garantir que les services accessibles, interdisciplinaires et flexibles mentionnés ci-dessus soient durables et efficaces dans le temps. Un thème important à cet égard est la notion d’autonomisation, soit, l’idée que « [l]es gouvernements doivent renforcer la capacité juridique des personnes, y compris leur capacité à participer et avoir voix au chapitre de la conception et la prestation des services »Footnote 31. Ce thème est étroitement lié aux objectifs discutés précédemment, car la participation « augmente le niveau de transparence, d’autonomisation et d’appropriation d’une communauté envers son système de justice, ce qui à son tour accroît sa durabilité »Footnote 32.
Un autre déterminant de la durabilité est l’orientation locale de la plupart des initiatives de justice centrée sur la personne. Cette approche a le potentiel de transformer la prestation des services juridiques à tous les niveaux, y compris à l’échelle nationale. Cependant, mettre l’accent sur les besoins de la population conduit naturellement à placer l’accent sur les services locaux. Des études ont révélé que la plupart des besoins juridiques se rapportent à des enjeux quotidiens vécus à une échelle relativement locale, par exemple l’achat de biens de consommation, les problèmes d’endettement, les questions d’emploi et les conflits avec les voisins et les membres de la familleFootnote 33. Les initiatives locales peuvent répondre à ces besoins de manière plus accessible et ainsi « combler le fossé actuel entre les personnes et les institutions, [en] rapprochant la justice des citoyens »Footnote 34. Les solutions locales, en raison de leur échelle plus restreinte, peuvent également être plus flexibles et donc mieux répondre à leur contexte et aux besoins de leur population locale.
Ce thème est étroitement lié à la connexité entre l’approche centrée sur la personne et la justice communautaire (community-based justice). Certains auteurs ont noté que la justice centrée sur la personne promet de fournir « des services de justice communautaires qui aident les gens à résoudre leurs problèmes d’une manière plus simple, près de l’endroit où ils vivent, en combinant la justice informelle et la justice formelle »Footnote 35. Cet accent mis sur les initiatives communautaires correspond aux objectifs de la justice centrée sur la personne en matière d’accessibilité, de flexibilité et de confiance. Comme le notent Farrow et Currie, « diverses organisations opérant au sein des communautés locales sont considérées comme des sources fiables d’aide et d’information juridiques »Footnote 36. De ce fait, elles « sont souvent en mesure d’identifier et de comprendre les besoins des membres de la communauté locale et de fournir des services, des solutions et des références adaptés à ces besoins », en particulier en réponse aux problèmes juridiques du quotidienFootnote 37.
Cet exposé des principaux thèmes qui sous-tendent le concept de justice centrée sur la personne permet d’en donner une définition plus précise. En résumé, la justice centrée sur la personne se caractérise par le fait qu’elle s’appuie sur des données empiriques probantes concernant les besoins juridiques des personnes. Ces besoins étant variés, elle donne la priorité à des services accessibles, flexibles et interdisciplinaires qui vont au-delà des institutions officielles de l’État pour recourir à des structures locales et communautaires qui donnent aux individus les moyens de participer à la résolution de leurs propres problèmes juridiques. Ensemble, ces thèmes visent à fournir des services plus réactifs et durables, renforçant à la fois le tissu social et la confiance de la population envers les institutions judiciaires.
2. Le règlement des différends centré sur la personne : un écueil d’ampleur
L’accent mis sur les besoins juridiques des justiciables conduit naturellement à privilégier les services de première ligne, tels que l’information et les conseils juridiques. Avant de se transformer en différend, les problèmes juridiques doivent d’abord être identifiés. Ces problèmes peuvent également être résolus à un stade précoce si des informations et des conseils adéquats, ainsi que des services de médiation, par exemple, sont fournis. Seule une fraction de tous les problèmes juridiques se transforme en litige, et la justice centrée sur la personne met à juste titre l’accent sur des modes d’intervention précoces. Cependant, comme nous l’avons indiqué en introduction du présent article, la justice centrée sur la personne promet également de transformer le règlement des différends, un type de service qui soulève des questions et des considérations d’un tout autre ordre.
Une différence importante entre le règlement des différends et les autres services juridiques est la fonction publique des tribunaux, dont il a été question précédemment. En s’appuyant sur certains des travaux cités ci-dessus, notamment ceux de Fiss et de GennFootnote 38, Trevor Farrow présente l’un des exposés les plus complets de cette fonction dans son livre Civil Justice, Privatization, and Democracy. Réagissant à la pression croissante en faveur de modes alternatifs de règlement des différends, et en particulier de l’arbitrage, il reconnaît qu’il existe des « justifications valables pour ces tendances à la privatisation » tout en soulignant que cette dernière a une « incidence négative […] sur les systèmes de gouvernance démocratique »Footnote 39. Essentiellement, puisque les tribunaux sont des « éléments centraux de la création et de la légitimation des normes publiques »Footnote 40, les réformes qui retirent des dossiers du système public de justice risquent de mettre en péril le développement de la common law et, par conséquent, les politiques et les normes selon lesquelles nous nous gouvernons en sociétéFootnote 41. Le défi consiste à déterminer les circonstances dans lesquelles un respect adéquat de cette fonction publique peut permettre un certain degré de privatisation, mais aussi à voir si le système public de justice peut s’adapter pour fournir des services plus efficaces et accessibles.
Ces observations incitent à la prudence en ce qui concerne les réformes inspirées par la conception de la justice centrée sur la personne décrite précédemment. Ces réformes peuvent viser les services juridiques tant publics que privés et, en ce sens, la justice centrée sur la personne n’a pas nécessairement à mener à une privatisation du règlement des différends. Mais se concentrer sur les besoins des personnes sans tenir compte de la fonction publique des institutions de règlement des différends risque précisément de mener à ce résultatFootnote 42. En effet, lorsqu’une personne éprouve un besoin juridique, elle cherche à résoudre son problème ou son conflit. Il est peu probable qu’elle pense ou se soucie beaucoup de l’incidence de son affaire sur les normes publiques. Les dimensions publiques de sa situation peuvent même entrer en conflit avec ses souhaits individuels – par exemple, le désir de rester privé ou de résoudre le différend le plus rapidement possible. Le résultat pourrait être la réduction du rôle du tribunal au profit de solutions de rechange privées. La juge Karakatsanis a laissé entendre, dans le même ordre d’idées, que l’accès à une justice centrée sur la personne « consiste à mettre l’accent sur les personnes qu’elle sert, en reconnaissant que les tribunaux sont un dernier recours, que la justice est souvent mieux servie en réglant les problèmes juridiques à l’extérieur des tribunaux »Footnote 43.
La crainte qu’une approche centrée sur la personne puisse miner la fonction publique du règlement des différends n’est pas que théorique. Dans le cadre d’une récente réforme de la procédure à la Cour du Québec, la législature provinciale a apporté des changements importants aux petites créances, en introduisant la médiation obligatoire et l’arbitrage gratuit. En conséquence, les parties à un large éventail de petites créances se verront proposer par le greffier de cette Cour de soumettre leur litige à un arbitre privé financé par l’État au lieu de comparaître devant un jugeFootnote 44. Cette proposition était motivée par les mêmes objectifs que la justice centrée sur la personne : même si le ministre n’a pas expressément utilisé ce concept, il a mentionné sa volonté de rendre la justice plus accessible, plus « humain[e] » et « centrée sur les besoins des citoyens »Footnote 45.
Ce changement soulève toutefois une préoccupation majeure. Dans sa première version, le projet de loi ne modifiait pas les règles de confidentialité régissant l’arbitrage, ce qui aurait signifié que le nouveau régime d’arbitrage automatique aurait transféré une grande partie des litiges relatifs aux petites créances à un forum privé rendant des décisions confidentielles. Cette proposition, motivée en substance par la justice centrée sur la personne, illustre les risques de cette approche lorsqu’elle est appliquée au règlement des différends : en mettant tout l’accent sur les besoins des justiciables, la fonction publique du système de justice risque de s’étioler. Au Québec, un amendement a finalement été adopté pour garantir que les sentences arbitrales seraient accessibles au public. Cet exemple récent illustre néanmoins l’un des principaux écueils d’une approche centrée sur la personne.
Cette préoccupation à l’égard de la privatisation du règlement des différends comme sous-produit de la justice centrée sur la personne peut sembler insignifiante à première vue. Après tout, la justice centrée sur la personne se concentre principalement sur les différends quotidiens à petite échelle, c’est-à-dire le type de litiges que nos cours des petites créances entendent fréquemment. Certains diront que ces affaires ont déjà un effet minime sur l’évolution du droit et que leur privatisation ne changerait finalement pas grand-choseFootnote 46. Cet argument souffre d’au moins trois difficultés. Premièrement, bien que la justice centrée sur la personne se concentre principalement sur les litiges de moindre ampleur, les réformes qu’elle stimulera pourraient, avec le temps, s’étendre à des litiges plus importants. La privatisation du règlement des différends dans le but d’atteindre les objectifs de la justice centrée sur la personne pourrait avoir une incidence importante sur la fonction publique du règlement des différends à mesure que les réformes se développent. Deuxièmement, même dans le contexte des petites créances où la valeur de précédent de toute décision individuelle demeure minime, l’intervention des tribunaux publics représentant le pouvoir de l’État contribue toujours à la fonction de légitimation des normes publiques identifiée par Farrow. Autrement dit, même lorsqu’ils se prononcent sur des petites créances, les tribunaux réaffirment les normes publiques qui nous gouvernent en société. Il s’agit d’une fonction importante du système de justice qui risque de s’éroder à mesure que de plus en plus d’affaires sont laissées à des mécanismes privés et secrets de règlement des différends.
Troisièmement, au-delà de cette incidence sur la création et la légitimation de normes publiques, la privatisation du règlement des différends pour atteindre les objectifs de la justice centrée sur la personne risque de transformer le rôle du règlement des différends, et le faire passer d’un mécanisme visant à façonner les relations dans les sociétés démocratiquesFootnote 47 à un pur outil de consumérisme. En centrant les services juridiques sur les besoins individuels, les approches centrées sur la personne risquent de considérer les services juridiques comme des produits auxquels les personnes aux prises avec des problèmes juridiques peuvent accéder pour répondre à leurs besoins. Cette vision peut ne pas poser de problèmes significatifs dans le contexte des services juridiques de première ligne tels que l’information ou les conseils juridiques – même si certaines personnes ont également contesté la consumérisation et la marchandisation de ces services –, mais elle soulève des questions importantes dans le contexte du règlement des différends. Toy-Cronin, dans ses écrits sur l’expérience de la Nouvelle-Zélande, critique le passage du système judiciaire de ce pays vers « la satisfaction du client [comme] mesure clé de performance »Footnote 48 – un changement qui reflète certains des objectifs de la justice centrée sur la personne – et affirme que cette transition laisse entendre de manière inappropriée « que les tribunaux sont un bien privé plutôt que public »Footnote 49, qu’ils « sont un service fourni aux citoyens comme tout autre : la bibliothèque, l’hôpital, le mécanicien »Footnote 50.
En résumé, bien que la justice centrée sur la personne puisse sans aucun doute guider l’élaboration de services de première ligne comme l’information et les conseils juridiques, il faut la tenir soigneusement en équilibre avec la fonction publique du système de justice lorsqu’elle est appliquée au règlement des différends. Toutefois, même dans ce contexte, la justice centrée sur la personne recèle un grand potentiel. Le défi consiste à concrétiser cette vision – des services fondés sur des données probantes, accessibles, flexibles, multidisciplinaires, autonomisants, locaux et communautaires – tout en évitant la tentation de privatiser le règlement des différends sans porter une attention particulière aux écueils de cette approche. Cela ne veut pas dire que le règlement privé des différends ne peut pas jouer un rôle dans la mise en œuvre de réformes centrées sur la personne, mais simplement que les intérêts concurrents évoqués ci-dessus doivent être pris en considération.
II. Le potentiel des tribunaux non professionnels dans le règlement des différends centré sur la personne
La question clé est donc la deuxième posée au départ, adaptée pour tenir compte de la préoccupation susmentionnée : comment le règlement des différends peut-il être « centré » concrètement, sur la personne tout en préservant la fonction publique du système de justice? Cette question évoque de nombreuses possibilités : les réformes peuvent chercher à centrer les processus judiciaires autour de la personne, ou elles peuvent envisager d’autres arrangements institutionnels pour atteindre cet objectif. La portée du présent article ne permet pas d’examiner toutes les réformes potentielles, mais cette dernière partie examinera une idée en particulier pour illustrer comment une institution de règlement des différends peut être centrée sur la personne tout en restant publique. Il appartiendra ensuite à d’autres études d’examiner plus en détail cette piste ou d’autres options.
1. Les tribunaux non professionnels : un aperçu
Un exemple intéressant d’institution publique susceptible de fournir un service de règlement des différends centré sur la personne est le modèle des tribunaux locaux non professionnels s’occupant des conflits de la vie quotidienne. Ces institutions existent déjà, sous une forme ou une autre, dans de nombreux autres ressorts, mais pas au Canada. Avant d’examiner le potentiel des tribunaux non professionnels à fournir un service de règlement des différends centré sur la personne tout en protégeant et même en renforçant la fonction publique des tribunaux, il peut être utile d’offrir un aperçu et un exemple de ce type d’institution.
Les tribunaux non professionnels sont des tribunaux dont les juges sont profanes, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tenus d’avoir une formation ou une expérience juridique quelconque avant leur nomination et qu’ils exercent leurs fonctions judiciaires à temps partielFootnote 51. Ce modèle contraste avec les tribunaux professionnels, qui emploient des juges ayant une formation et une expérience juridiques approfondies et qui exercent leurs fonctions judiciaires de manière exclusive et à temps pleinFootnote 52. Les tribunaux non professionnels sont l’une des nombreuses voies par lesquelles les justiciables peuvent participer à l’administration de la justice. De récentes études internationales portant sur les juges non professionnels en matière pénale et civile ont conclu qu’une majorité de pays ont recours à des juges non professionnels sous une forme ou une autre, par exemple, par l’intermédiaire de jurys ou de tribunaux mixtesFootnote 53. Toutefois, comme détaillé ci-après, la forme de justice non professionnelle la plus prometteuse en matière de recentrage sur la personne est celle des tribunaux composés exclusivement de juges non professionnels, qui opèrent généralement au palier local et se chargent des litiges de la vie quotidienne.
Les tribunaux non professionnels ont des rôles et des caractéristiques variables, mais l’exemple de la magistrature non professionnelle de l’Angleterre et du pays de Galles illustre le phénomène. Composée de plus de 12 000 bénévoles, la magistrature non professionnelle fait partie de l’échelon inférieur du système de justice de ce paysFootnote 54. Elle traite plus de 90 % de toutes les affaires pénales ainsi qu’un large éventail d’affaires civiles liées aux conflits familiaux et à la collecte des taxes localesFootnote 55. Nommés par le pouvoir judiciaire sur l’avis de conseils consultatifs locauxFootnote 56, les magistrats non professionnels siègent en groupes de trois dans la plupart des casFootnote 57, avec l’assistance d’un greffier formé en droit.Footnote 58 Ces tribunaux non professionnels sont semblables à leurs homologues professionnels en ce qu’ils offrent le même service de règlement des différends fondé sur le droit que le système public de justice. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, ils diffèrent sur des aspects importants, ce qui leur permet d’offrir un service davantage centré sur les personnes et leurs besoins.
2. Des tribunaux professionnels aux tribunaux non professionnels : un changement centré sur la personne
Cette section compare les tribunaux professionnels et non professionnels dans leurs aspects les plus pertinents pour la justice centrée sur la personne. Elle ne prétend pas fournir une comparaison exhaustive de leurs caractéristiques, de leurs avantages et de leurs coûts, mais met en évidence un modèle différent de tribunaux qui pourraient fournir un service public de règlement des différends centré sur la personne.
L’un des thèmes centraux de la justice centrée sur la personne, comme discuté dans la première partie de cet article, est l’accessibilité des services juridiques. De ce point de vue, la présence locale des tribunaux non professionnels les rend souvent plus accessibles que les tribunaux professionnels. Le recours à des juges non professionnels réduit les ressources nécessaires à leur fonctionnement, ne serait-ce que parce que ces juges sont généralement bénévoles tandis que les juges professionnels reçoivent des salaires correspondant à leur rôle et à leur expertiseFootnote 59. En Angleterre et au pays de Galles, par exemple, le coût du travail accompli par des magistrats non professionnels est environ la moitié de ce qu’il en coûterait s’il était fait par des tribunaux professionnelsFootnote 60. Cette réduction des coûts est importante parce qu’elle signifie qu’il peut y avoir environ deux fois plus de tribunaux non professionnels pour le même investissement, ce qui permet une plus grande décentralisation et une plus grande accessibilité pour les communautés locales. L’aspect local des tribunaux non professionnels est bien apparent en Angleterre et au pays de Galles, où les magistrats non professionnels sont affectés à une « zone de justice locale » particulière dans ou à proximité de laquelle ils doivent vivre ou travailler et où ils sont beaucoup plus présents que les juges professionnelsFootnote 61.
Les tribunaux non professionnels ont également tendance à être plus accessibles d’un point de vue procédural, offrant un service plus compréhensible, plus accueillant et plus sensible aux besoins des parties et, par conséquent, plus flexible. En raison de leur formation, les juges professionnels ont tendance à adopter une approche légaliste des litiges qui reconfigure les histoires humaines afin de les faire entrer dans des catégories juridiquesFootnote 62. En outre, leurs fonctions judiciaires à plein temps conduisent souvent à la routinisation et au durcissement (case-hardening), lesquels aggravent cette approche légalisteFootnote 63. En conséquence, « les systèmes juridiques et les institutions juridiques formelles peuvent être difficiles à naviguer et, dans certains cas, être intimidants pour les gens ordinaires »Footnote 64. Inversement, des études empiriques ont montré que les juges non professionnels adoptent souvent une approche plus accueillante qui utilise un langage moins technique et appréhende les histoires des justiciables dans toute leur complexité, même si leurs décisions restent fondées sur le droitFootnote 65. Cette approche différente a été observée en Angleterre et au pays de Galles, où les magistrats non professionnels sont perçus comme rendant les instances plus compréhensibles et accueillantesFootnote 66. Un tel résultat reflète les objectifs d’une justice centrée sur la personne parce qu’il présente le règlement des différends comme un service qui aide les gens à résoudre leurs problèmes de manière plus holistique et plus flexible, et non simplement comme un processus technique de résolution des problèmes juridiques. Comme l’ont noté plusieurs auteurs, ce type d’interaction interpersonnelle entre les parties et les décideurs est essentiel pour améliorer l’expérience des parties et leur perception de l’équité du processus, deux objectifs qui s’inscrivent en ligne directe avec la justice centrée sur la personneFootnote 67.
Cette approche différente envers le processus judiciaire contribue également à l’autonomisation, un autre des thèmes clés de la justice centrée sur la personne. Comme indiqué précédemment, l’approche plus accueillante des juges non professionnels donne aux parties plus de flexibilité et, par conséquent, plus de contrôle sur la façon dont elles participent au processus judiciaire. Mais au-delà des parties, les tribunaux non professionnels donnent aux membres de la communauté les moyens de résoudre les différends de leurs pairs. À l’instar de diverses expériences de démocratie participative, dont il a été démontré qu’elles « renforcent le sentiment d’efficacité politique et d’autonomisation des citoyens »Footnote 68, les tribunaux non professionnels contribuent également au sentiment d’autonomisation des membres de la communauté. Cette contribution se reflète dans la magistrature non professionnelle en Angleterre et au pays de Galles. L’une des justifications du maintien de l’institution au fil du temps est précisément le fait qu’elle permet à des milliers de personnes de participer à l’administration de la justiceFootnote 69. La participation n’est pas seulement recherchée comme une fin en soi; elle vise aussi à renforcer « le tissu social » en créant des liens parmi les magistrats et entre ces derniers et leurs communautés.Footnote 70 Une étude a d’ailleurs confirmé que l’une des forces perçues des magistrats non professionnels est leur association « à un plus grand degré de démocratie »Footnote 71.
Enfin, en raison de leur effet d’autonomisation sur les communautés locales, les tribunaux non professionnels contribuent également aux objectifs de la justice locale et communautaire. Les juges professionnels sont limités dans leurs activités hors de la salle d’audience en raison de leur charge de travail à temps plein et peuvent, pour cette raison, s’isoler de leur communautéFootnote 72. En revanche, les juges non professionnels qui exercent leurs fonctions judiciaires à temps partiel contribuent à la société en dehors de la salle d’audience de multiples façons. Ils occupent souvent d’autres postes et peuvent être bénévoles pour des organismes communautaires. Ces activités leur permettent d’être en contact de façon continue avec les membres des communautés qu’ils servent. Ils évitent ainsi de s’isoler de la société, ce qui leur permet d’acquérir une expérience précieuse de la « vie réelle », expérience qu’ils mettent ensuite à profit dans l’exercice de leurs fonctions judiciairesFootnote 73. En outre, le fait que les juges non professionnels à temps partiel traitent moins de litiges les rend moins vulnérables à l’endurcissement. En Angleterre et au pays de Galles, par exemple, il a été démontré « que la nature à temps partiel du travail des magistrats peut contribuer dans une certaine mesure à limiter leur “cohésion” dans le processus judiciaire, ce qui peut fournir une protection importante contre la formation de “cliques” et l’endurcissement »Footnote 74. Les liens entre les tribunaux non professionnels et les communautés qu’ils servent sont une caractéristique clé de la magistrature non professionnelle de l’Angleterre et du pays de Galles, que les auteurs ont décrite « comme une justice locale rendue par des membres choisis de la communauté locale »Footnote 75.
En incarnant ces différents thèmes de la justice centrée sur la personne, les tribunaux non professionnels pourraient aider le système de justice à atteindre les objectifs décrits précédemment, y compris le rétablissement de la confiance envers les institutions judiciaires et le renforcement du tissu social et de la démocratie. Grâce à l’occasion de participation qu’elle offre aux membres de la communauté locale et à sa capacité d’offrir un processus judiciaire plus adapté aux besoins des parties, la magistrature non professionnelle de l’Angleterre et du pays de Galles, par exemple, s’est révélée être un forum légitime de règlement des différendsFootnote 76. En bref, les tribunaux non professionnels s’alignent étroitement sur la justice centrée sur la personne, tout en restant des institutions publiques, offrant ainsi une voie potentielle pour résoudre la tension décrite précédemment entre les fonctions privée et publique du règlement des différends.
3. Une réponse aux enjeux que soulèvent les tribunaux non professionnels
Malgré tous leurs avantages potentiels, la mise en place de tribunaux non professionnels dans les sociétés modernes s’accompagne de défis importants. Plusieurs préoccupations peuvent être soulevées, par exemple en lien avec les effets d’une déformalisation du processus judiciaire, l’intégration de ces tribunaux avec les tribunaux professionnels au moyen d’appels ou de pourvois en contrôle judiciaire, les garanties nécessaires pour s’assurer que les tribunaux non professionnels ne deviennent pas un mécanisme de règlement des différends de deuxième classe pour les groupes défavorisés, et de nombreux autres défis qui peuvent être résolus en grande partie en portant une attention particulière à la conception institutionnelle de ces tribunauxFootnote 77. Cette dernière partie de l’article, s’attarde à deux des principaux défis auxquels sont confrontés les tribunaux non professionnels, à savoir la compétence et l’indépendance de leurs juges.
En ce qui concerne la compétence, la plupart des sociétés modernes sont « riches en droit » (law-thick), ce qui signifie que le droit imprègne la majorité des aspects de la vieFootnote 78. La complexité croissante des textes juridiques pose un défi aux juges non professionnels, qui n’ont aucune formation juridique ni expérience leur permettant de trouver, interpréter et appliquer des concepts juridiquesFootnote 79. Ils peuvent recevoir une certaine formation, et un greffier formé en droit peut même les soutenir – comme c’est le cas avec les magistrats non professionnels en Angleterre et au pays de Galles – mais ces mécanismes de soutien ne sont pas suffisants pour permettre aux juges non professionnels de traiter des questions juridiques complexes de la même manière que les professionnels du droit.
Toutefois, ce souci pour la compétence judiciaire n’a qu’une pertinence limitée dans les litiges simples. Prenons l’exemple de l’affaire Desaulniers Footnote 80, une action en recouvrement de créance similaire à celles dont nos cours des petites créances sont fréquemment saisies, dans lesquelles un créancier poursuit un débiteur pour défaut de paiement. Dans cette affaire, les règles applicables étaient simples et faciles à cerner. En fait, le juge qui a résolu cette affaire n’a cité aucune règle de droit dans sa décision, se référant uniquement à la notion générale de rupture de contrat. En matière de raisonnement juridique, les cas simples comme celui-ci font souvent appel à un raisonnement déductif plutôt qu’à une interprétation législative complexe ou à des catégorisations factuellesFootnote 81. En conséquence, des études en psychologie suggèrent que, dans de tels cas, les juges non professionnels sont tout aussi capables que les juges professionnels de tirer des conclusions rationnelles en conformité avec le droit applicableFootnote 82. En effet, une étude de juges non professionnels de New York chargés de résoudre des affaires pénales et civiles mineures et généralement simples n’a révélé pratiquement aucune différence de raisonnement par rapport aux juges professionnels, en particulier en ce qui concerne l’attention portée aux droits des parties et à la régularité de la procédureFootnote 83.
Pour que la justice non professionnelle soit un complément efficace aux autres mécanismes de règlement des différends, il faut donc s’écarter de l’approche unique qui prévaut actuellement et adopter une approche qui tienne compte de la nature et de la complexité de chaque litige. Pour ce faire, il faut mettre en place des mécanismes de triage afin de déterminer si un différend se prête à une décision non professionnelle ou s’il est trop complexe sur le plan juridique et nécessite l’intervention d’un juge professionnelFootnote 84. De tels mécanismes, souvent gérés par des acteurs professionnels (par exemple, des juges ou des greffiers), existent déjà en Angleterre et au pays de Galles et dans d’autres pays. En outre, cette façon d’organiser nos institutions publiques de règlement des différends s’harmonise avec la justice centrée sur la personne. Comme une représentante de l’OCDE l’a récemment fait remarquer, la compréhension des différents besoins juridiques des personnes conduit naturellement à reconnaître que nous avons besoin « d’un large éventail de mécanismes de règlement des différends capables de répondre à une variété de besoins »Footnote 85. Dans cette optique, il faut reconnaître qu’il peut être contre-productif de confier à des professionnels le soin de résoudre des litiges simples émanant de la vie quotidienne.
Une deuxième préoccupation liée à la justice non professionnelle est le maintien de l’indépendance judiciaire. L’indépendance judiciaire peut être définie comme « la capacité des tribunaux à fonctionner sans interférence réelle ou apparente de quiconque, en particulier des pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement »Footnote 86. Elle est essentielle à l’impartialité du pouvoir judiciaire et, par conséquent, à sa légitimité. L’indépendance judiciaire doit donc être un élément central de toute conception de la justice centrée sur la personneFootnote 87. Le rôle à temps partiel des juges non professionnels peut poser un défi à cet égard. Premièrement, puisqu’ils doivent gagner leur vie en dehors de leurs fonctions judiciaires, leurs engagements extrajudiciaires peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts. Deuxièmement, il existe un risque que l’exécutif influence les affectations des juges non professionnels à temps partiel. Par exemple, l’exécutif pourrait accorder plus de jours d’audience aux juges qui sont réceptifs aux demandes des acteurs gouvernementaux et limiter le nombre de jours d’audience des juges qui leur sont moins favorables, comme c’était autrefois le cas avec les juges de paix au CanadaFootnote 88.
Toutefois, un poste à plein temps n’est pas le seul moyen de réduire ces risques; d’autres garanties peuvent protéger efficacement l’indépendance judiciaire des juges non professionnels. Par exemple, le pouvoir d’attribuer des jours d’audience aux juges non professionnels pourrait être retiré à l’exécutif et confié à l’un des juges non professionnels ou à un officier indépendantFootnote 89. En outre, des exigences strictes devraient être imposées aux juges non professionnels au moyen d’un code de déontologie afin de clarifier leurs normes de conduite et de s’assurer qu’ils se récusent en cas de conflit d’intérêtsFootnote 90.
En conséquence, bien qu’il soit justifié de se préoccuper de la compétence et de l’indépendance des juges non professionnels, les tribunaux au sein desquels ils siègent peuvent être conçus de manière à garantir qu’ils ne s’occupent que d’affaires juridiquement simples et qu’ils le fassent de manière indépendante et impartiale.
Conclusion
L’un des aspects les plus puissants de la justice centrée sur la personne est l’attrait instinctif qu’elle exerce sur différents groupes d’intérêt. Comme l’a noté Iavarone-Turcotte, l’idée de centrer les services de justice sur la personne bénéficie d’un large soutien non seulement parmi les observateurs du système de justice, mais aussi au sein du système lui-mêmeFootnote 91. Ce soutien n’est pas une mince affaire compte tenu de la résistance au changement dans les milieux juridiques.
Cependant, si la justice centrée sur la personne doit servir à guider les réformes de la justice, il faut la définir clairement et mieux comprendre ses ramifications. Cet article a cherché à préciser la définition de la justice centrée sur la personne au moyen d’une analyse thématique réflexive de la littérature. Il a fait valoir que, bien que la justice centrée sur la personne établisse des objectifs clairs conformes aux besoins documentés des justiciables, son application au règlement des différends soulève des questions d’un autre ordre, qui doivent être mises en équilibre avec une approche centrée sur la personne. Notamment, une focalisation étroite sur les besoins des individus pourrait conduire à la privatisation du règlement des différends, ce qui pourrait poser des risques importants à sa fonction publique. Cette préoccupation ne doit pas nécessairement constituer une opposition à la justice centrée sur la personne, mais elle a le potentiel d’affiner notre compréhension de ce concept. Concrètement, cet article a fait valoir que les tribunaux non professionnels représentent l’une des nombreuses voies possibles pour offrir des services de règlement des différends centrés sur la personne tout en préservant la fonction publique du système de justice. Bien ancrés dans les communautés locales, les tribunaux non professionnels ont le potentiel d’offrir à la population un forum de règlement des différends accessible, flexible et holistique, en donnant au justiciable les moyens d’agir, que ce soit en tant que partie ou comme magistrat.
Au-delà de ce qui a été examiné dans cet article, la justice centrée sur la personne soulève de nombreuses autres questions qui n’ont pas encore été abordées. Par exemple, à l’instar de la plupart des sources consacrées à la justice centrée sur la personne, la présente analyse tient pour acquis que la personne qui demande de l’aide est un individu. Or, les systèmes de justice servent également les personnes morales. Dans des documents récents sur la justice centrée sur la personne, l’OCDE met l’accent sur les besoins des particuliers et des petites et moyennes entreprises, mais pas sur ceux des grandes entreprisesFootnote 92. Ce choix est chargé de valeurs et suppose la nécessité de clarifier les postulats sur lesquels se fonde la justice centrée sur la personne. Il reste encore beaucoup à faire, mais la justice centrée sur la personne a néanmoins le potentiel de catalyser le changement.
Abstract
Discussions around access to justice increasingly refer to person-centred justice without clearly defining that concept. This article develops a more precise definition through a reflexive thematic analysis of the literature. In doing so, it identifies a key challenge that arises when that concept is applied to dispute resolution: while person-centred justice sets out laudable goals, its current versions fail to account for the role of dispute resolution in developing the law. The article argues that any person-centred reform must balance individual needs with that public function of adjudication. The tension between these competing concerns opens a space for considering alternative institutional arrangements that could provide a public dispute resolution service while being more responsive to private needs. To illustrate that possibility, the last section of the article casts lay courts—local institutions led by judges untrained and inexperienced in law—as a potential option for person-centred reform.
Keywords
access to justice
lay justice
lay courts
public justice system
Introduction
In its simplest expression, person-centred justice means that justice should be centred on the person. But, beyond this tautology, the precise contours and implications of the concept remain uncertain. Several normative and practical questions arise. On the normative front, should person-centred justice be the only, or even the primary, principle that drives justice reforms? On the practical front, how can a service or institution be “centred,” concretely, on the person? And, on these two fronts—the normative and the practical—should person-centred justice apply differently to different services, such as dispute resolution versus legal information and advice?
This article explores these questions while focusing on the implications of person-centred justice for dispute resolution. At first glance, this focus may seem antinomic. Most of the literature on person-centred justice advocates for a shift away from formal institutions towards a range of services that allow people to prevent and resolve their legal problems at an early stage.Footnote 93 These services may include community legal clinics, paralegal advice, legal health checks, and other front-line initiatives. However, the concept of person-centred justice is far-reaching and promises to transform dispute resolution as well.Footnote 94 For that reason, its implications for dispute-resolution institutions—both those of the state and their alternatives—must be considered.Footnote 95
Before discussing these implications, a necessary first step is to define person-centred justice. While the concept features increasingly in debates around access to justice, it still lacks a clear definition. Part I thus starts by tracing the main contours of person-centred justice through a reflexive thematic analysis of the literature. This exercise reveals an important pitfall of person-centred justice when applied to dispute resolution: while person-centred justice sets out laudable goals in that context (as in others), its current versions fail to account for the role of courts in guiding the development of the law in democratic societies. The absence of that public function of adjudication from the current discourse around person-centred justice likely results from the emphasis, in that discourse, on legal services that cater to private needs. However, when it is applied to dispute resolution, I argue that person-centred justice must account for that crucial public function.
This tension between the public and private functions of adjudication is not easy to resolve in practice, which leads to a second question: How, concretely, may we provide person-centred dispute-resolution services without impeding the courts’ public function? Potential reforms may seek to centre the process of existing courts around the person, but alternative institutional arrangements may also be considered. Part II illustrates that point by suggesting that lay courts—local institutions led by “ordinary” people who are untrained and inexperienced in law—could offer person-centred dispute resolution while upholding the public function of the justice system. While lay courts are not the only avenue for the achievement of that goal, I argue that they provide an interesting example of the types of reforms that person-centred justice might inspire.
I. Person-Centred Justice
The concept of person-centred justice eludes precise definition because of its flexibility and potential application to a wide range of situations.Footnote 96 Yet, if the concept is to be used to shape justice reforms, then we must develop a clear definition and better understand its implications. Most authors and organizations have adopted versions of person-centred justice that, despite their differences, can be articulated around common themes. This section attempts to distill these themes through a reflexive thematic analysis of the existing literature before critiquing them in the context of dispute resolution.
1. Themes and Definition
This section aims to develop a more precise definition of person-centred justice that is grounded in existing literature. This endeavour is “constructionist” in the sense that it “interrogate[s] meaning-making” and “center[s] on the social construction of reality”Footnote 97—in this case, seeking to identify the construction of person-centred justice in different contexts. An appropriate methodology to explore this type of question is reflexive thematic analysis, which aims not merely to summarize a set of themes that are found in the literature, but also to interpretively construct “patterns of meaning anchored by a shared idea or concept.”Footnote 98 The themes are thus “produced by the researcher through their systematic analytic engagement with the data set”Footnote 99—in this case, a comprehensive collection of scholarly and non-scholarly literature on person-centred justice.Footnote 100
Because a reflexive approach to thematic analysis embraces the researcher’s perspective, it must acknowledge the theoretical assumptions that underpin the research.Footnote 101 In this case, the analysis is framed by a key tension between the private and public functions of our justice system. These two functions have been the subject of a rich body of literature that has developed mainly in reaction to various trends towards the privatization of justice, including greater emphasis on settlements and the diversion of disputes to mediation and arbitration. A brief account of that literature will ground the thematic analysis that follows.
While recognizing the benefits that privatizing disputes might entail for some litigants, authors caution against its risks to public justice. Fiss famously argued that the diversion of cases away from courts might hamper their ability to develop the common law.Footnote 102 This concern reflects the idea that justice provides a service, not only to individuals—that is, resolving their disputes—but also to the community in refining the norms by which we govern ourselves in society. In that vein, Genn argues that “the civil justice system is a public good that serves more than private interests” because “civil courts contribute quietly and significantly to social and economic well-being.” Privatization, from that perspective, reduces justice to a mere private good.Footnote 103 Other authors, including Resnik and Lahav, articulate a similar argument around the idea of democracy: in democracies, public courts provide “opportunities for participatory parity that both enable democratic dialogue among disputants and impose constraints upon them.”Footnote 104 In short, while courts provide a private service to litigants, they also play a key public role that risks being affected when reforms divert cases from them. A person-centred approach to justice potentially raises concerns in that regard.
The thematic analysis that is developed in this article seeks to reflexively engage with that tension to construct the central themes around which current conceptions of person-centred justice are articulated. This analysis yields six main themes, discussed in greater detail below. The first one is the importance of collecting evidence on people’s legal needs. The nature of those needs, as identified in recent surveys, informs two further themes, namely the importance of services being both accessible and sufficiently flexible and interdisciplinary to address people’s needs holistically. The fourth theme is the importance of empowerment in making these efforts sustainable. Finally, while a person-centred approach may inspire change at different levels, the first four themes naturally encourage local and community-based initiatives, which can be identified as the fifth and sixth themes of person-centred justice.
Before exploring these themes further, it is helpful to understand why person-centred justice has emerged and what issues it seeks to address. In the field of international development, early versions of person-centred justice appeared in reaction to the traditional rule-of-law programming of aid agencies. In 2008, the Commission on Legal Empowerment of the Poor highlighted how these initiatives often failed to provide sustainable and effective justice to local populations because they focused almost exclusively on formal institutions.Footnote 105 The report called for a shift away from these structures towards measurable outcomes that reflect people’s experiences.Footnote 106 While the report did not expressly refer to person-centred justice, it planted the seeds from which the concept grew.
Since then, person-centred justice has been widely adopted at the international level.Footnote 107 Multiple organizations use that concept to call for reforms that not only respond to unmet legal needs,Footnote 108 but do so in a way that “strengthen[s] society’s bonds, enable[s] democracies to deliver on their people’s expectations, and […] re-establish[es] trust between people and governments.”Footnote 109 By aiming to provide legal services that are not only quick and efficient, but also trusted and empowering, a person-centred approach strives to provide justice more sustainably and effectively. The question that arises, then, is how a person-centred approach can achieve these objectives better than traditional interventions. This is where the themes that were mentioned at the outset come into play. These themes are constructed from the literature, most of which is articulated around the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)’s 2021 Framework on People-Centred Justice. Footnote 110
The first pillar of that framework—“designing justice responses based on an empirical understanding of people’s legal and justice needs”Footnote 111—represents the first key theme of person-centred justice, namely the importance of collecting and relying on evidence about people’s legal needs and their experience with justice institutions. While empirical research on access to justice has gained importance in recent decades, it has focused chiefly on discrete programmes and reforms.Footnote 112 According to Sandefur and Burnett, the shift to a person-centred approach means assessing access to justice through data that are not primarily about these institutions, but about “impacts on the experiences of ordinary people.”Footnote 113 These experiences include not only traditional metrics on costs and delays, but also indicators about “circumstances and emotions—how people experience legal and justice problems, and how they engage available pathways to address them.”Footnote 114
The focus of person-centred justice on evidence about individuals’ needs and experiences drives the other key themes of the concept. Because the research suggests that legal needs remain largely unmet, the second theme that underlies the concept of person-centred justice is the accessibility of legal services. In Canada, for instance, studies have shown that almost half of the adult population will experience at least one serious legal problem over a three-year period and that, although 95 percent of those people will make some attempt to resolve their problems, about 75 percent will do so through informal channels, including non-legal assistance, searches on the Internet, direct contact with the other party, or consultation with friends and relatives.Footnote 115 To address this situation, person-centred justice aims to make a wide range of formal and informal services accessible to everyone.Footnote 116
Empirical studies have also revealed that legal problems are intertwined with various issues that are related, for instance, to social programmes, health, employment, education, and financial resources.Footnote 117 In keeping with its focus on evidence, person-centred justice responds to this observation with two further themes. First, it prioritizes interventions that address not only the legal dimensions of people’s problems, but also their root causes and other implications, “prevent[ing] larger issues from arising and resolv[ing] them as they arise.”Footnote 118 In other words, person-centred services strive to be “an expression of holistic and integrated justice.”Footnote 119 In many cases, this requires an interdisciplinary response that involves actors from different sectors. This type of response is particularly important given the inability of many people to identify the legal implications of the problems that they face. The building of interdisciplinary structures in which both legal and non-legal services are provided concurrently increases the likelihood of reaching individuals who may not identify the legal dimensions of their problems but may intuitively seek the help of other trusted service providers, such as healthcare workers.
The fourth theme, which is closely related to interdisciplinarity, is the idea that legal services should be flexible enough to adapt to the multifaceted needs of different individuals. While formal institutions—especially those of the state—often adopt a one-size-fits-all approach, person-centred “services should be tailored to meet the varying needs of diverse groups.”Footnote 120 Different constituencies may not have the same needs or the same experience with legal services, and they may therefore require different interventions.Footnote 121 This means that “[p]eople-centred justice services are those that are most appropriate for the particular person to address the problem or problems they face in their particular circumstances, and are cost-effective and sustainable.”Footnote 122
This reference to cost-effectiveness and sustainability points to the last three themes of person-centred justice, which aim to ensure that the accessible, interdisciplinary, and flexible services that were discussed above are sustainable and effective over time. One important theme in that respect is the notion of empowerment, which means that “[g]overnments need to foster legal capability of people, including their capacity to participate, and have a voice in the design and delivery of services.”Footnote 123 This theme is closely connected to the objectives that were discussed previously, as participation “increases the level of transparency, empowerment, and ownership a community has in its justice system, thus increasing sustainability.”Footnote 124
Another key driver of sustainability is the local focus of most person-centred justice initiatives. Person-centred approaches have the potential to transform the delivery of legal services at all levels, including on a national scale. However, the focus on people’s needs naturally leads to an emphasis on local services. Studies have revealed that most legal needs pertain to everyday matters that are experienced at a relatively local scale, including consumer purchases, debt issues, employment issues, and conflicts with neighbours and family members.Footnote 125 Local initiatives can respond to these needs in a more accessible way and thus “bridge the current gap between people and institutions, [by] bringing justice closer to the citizens.”Footnote 126 Local solutions, because of their smaller scale, can also be more flexible and thus more responsive to their context and the needs of their local population.
Closely connected to this theme is the link between a person-centred approach and community-based justice. Some authors have noted how person-centred justice promises to provide “[c]ommunity justice services that help people with a simpler way to resolve problems, close to where they live, combining informal and formal justice.”Footnote 127 This focus on community initiatives matches the objectives of person-centred justice in terms of accessibility, flexibility, and trust. As Farrow and Currie note, “various organizations operating within local communities are seen as sources of justice-related information and trusted help.”Footnote 128 Because of that, they “are often able to identify and understand the needs of local community members and to provide tailored services, solutions and referrals for those needs,” particularly in response to everyday legal problems.Footnote 129
This account of the main themes that underlie the concept of person-centred justice yields a more precise definition. In short, person-centred justice is characterized by its grounding in robust empirical evidence about people’s legal needs. Because these needs are multifaceted, it prioritizes accessible, flexible, and interdisciplinary services that look beyond formal state institutions in favour of local and community-based structures that empower individuals to participate in the resolution of their own legal problems. Together, these themes aim to provide more responsive and sustainable services, strengthening both the social fabric and the people’s trust in justice institutions.
2. Person-Centred Dispute Resolution: A Key Challenge
The focus on people’s legal needs naturally leads to an emphasis on front-line services, such as legal information and advice. Before legal problems are litigated, they must be identified. These problems may also be resolved at an early stage if adequate information and advice, as well as mediation services, for example, are provided. Only a fraction of all legal problems become disputes, and person-centred justice rightly emphasizes early modes of intervention. However, as discussed in the introduction to this article, person-centred justice also promises to transform dispute resolution—a type of service that raises different questions and considerations.
One important difference between dispute resolution and other legal services is the courts’ public function, previously discussed in this article. Building on some of the works cited above, including that by Fiss and Genn,Footnote 130 Trevor Farrow puts forward one of the most complete accounts of this function in his book Civil Justice, Privatization, and Democracy. Reacting to the growing push towards alternative dispute-resolution methods, and especially arbitration, he acknowledges the “sound reasons for these privatization trends” while highlighting “the negative impact” of that privatization “on systems of democratic governance.”Footnote 131 Essentially, because courts matter “as central features of public norm generation and legitimation,”Footnote 132 reforms that remove cases from the public justice system risk endangering the development of the common law and, as a result, the policies and norms by which we govern ourselves in society.Footnote 133 The challenge is to determine the circumstances under which adequate regard to that public function may allow some degree of privatization, but also to see whether the public justice system can adapt to provide more efficient and accessible services.
These observations suggest a word of caution for reforms that are inspired by the conception of person-centred justice that was identified earlier in this article. These reforms can target both public and private legal services, and, in that sense, person-centred justice need not lead to a privatization of dispute resolution. But there is a risk that a focus on people’s needs, without adequate regard for the public function of dispute-resolution institutions, will lead to precisely that result.Footnote 134 Indeed, when individuals experience legal needs, they seek the resolution of their issue or conflict. They are unlikely to think or care very much about the impact of their case on public norms. The public implications of their situation may even conflict with their individual wishes—for instance, the desire to remain private or to resolve their dispute as quickly as possible. The result may be to shrink the role of courts in favour of private alternatives. Justice Karakatsanis suggested, in that vein, that person-centred access to justice “is about keeping the focus on the people it serves, and recognizing that courts are a last resort, that justice is often best served by resolving legal issues outside of the courts.”Footnote 135
The concern that a person-centred approach may undermine the public function of dispute resolution is not theoretical. As part of a recent procedural reform in the Court of Québec, the provincial legislature made sweeping changes to the adjudication of small claims, introducing mandatory mediation and free arbitration. As a result, litigants in a range of small claims will receive an offer from the court’s clerk to submit their dispute to a publicly funded private arbitrator instead of proceeding before a judge.Footnote 136 This proposal was motivated by the same objectives as person-centred justice: even if the minister did not expressly use that concept, he mentioned seeking to make justice more accessible, more “human,” and “centred on the needs of citizens.”Footnote 137
This change, however, raises a key concern. In its first version, the bill did not alter any confidentiality rules that govern arbitration, meaning that the new automatic arbitration scheme would transfer a large share of small claims disputes to a private forum that issues confidential decisions. This proposal, motivated in substance by person-centred justice, illustrates the risks of that approach when applied to dispute resolution: if we focus only on the needs of individual litigants, then the public function of the justice system may wither away. In Quebec, an amendment was ultimately adopted to guarantee that arbitrators’ awards would be publicly available. Still, this recent example illustrates one of the main pitfalls of a person-centred approach.
This concern that the privatization of dispute resolution is one of the by-products of person-centred justice may initially seem insignificant. After all, person-centred justice focuses primarily on everyday disputes on a small, local scale—the type of disputes that our small claims courts frequently hear. Some may argue that these cases already have a minimal impact on the development of the law and that privatizing them would make no real difference in the end.Footnote 138 There are at least three difficulties with this line of argument. First, while person-centred justice primarily focuses on smaller disputes, the reforms that it will spur may, in time, extend to more consequential disputes. The privatization of dispute resolution to achieve person-centred justice goals could have a serious impact on the public function of dispute resolution as reforms unfold. Second, even in the context of small claims, in which the precedential value of any single decision may be minimal, the intervention of public courts that represent state power still contributes to the function of public norm legitimation that was identified by Farrow. Put otherwise, even when they decide on small claims, courts reaffirm the public norms by which we govern ourselves in society. This is an important function of the justice system that risks being eroded as more and more cases are left in the hands of secretive, private dispute-resolution mechanisms.
Third, beyond its impact on public norm generation and legitimation, the privatization of dispute resolution to achieve person-centred justice goals risks changing the role of dispute resolution from a mechanism to shape relationships in democratic societiesFootnote 139 to a pure tool of consumerism. By centring legal services on individual needs, person-centred approaches risk casting legal services as products that people who are experiencing legal problems can access to serve their needs. This vision may not pose significant issues in the context of front-line legal services such as legal information or advice—even if some people have challenged the consumerization and commodification of these services as well—but it raises important questions in the context of dispute resolution. Toy-Cronin, when writing about New Zealand’s experience, criticizes the shift of that country’s justice system to “customer satisfaction [as] a key performance measure”Footnote 140—a shift that reflects some of the objectives of person-centred justice—as suggesting inappropriately “that courts are a private rather than public good”Footnote 141 and that they “are a service provided to the citizenry like any other: the library, the hospital, the mechanic.”Footnote 142
In short, while person-centred justice can undoubtedly guide the development of front-line services such as legal information and advice, it must be carefully balanced with the public function of the justice system when applied to dispute resolution. Even in that context, however, person-centred justice holds great potential. The challenge is to realize that vision—evidence-based, accessible, flexible, multidisciplinary, empowering, local, and community-based services—while avoiding the temptation to privatize dispute resolution without carefully considering the pitfalls of that approach. This is not to say that private dispute resolution cannot play a role in the implementation of person-centred reforms, but simply that countervailing interests of the type discussed above must be considered.
II. Lay Courts’ Potential for Person-Centred Dispute Resolution
The key question, then, is the second one asked at the outset, refined to take into account the abovementioned concern: How may dispute resolution be “centred,” concretely, on the person while upholding the public function of the justice system? This question evokes many possibilities: reforms may seek to centre court processes on the person, or they may contemplate alternative institutional arrangements to achieve that objective. The scope of this article does not allow a consideration of every potential reform, but this last part will explore one idea to illustrate how a dispute-resolution institution may be centred on the person while remaining public in nature. It will then be up to future research to explore this avenue or others in greater detail.
1. Lay Courts: An Overview
An interesting example of a public institution that might provide a person-centred dispute-resolution service is the model of local lay courts that deal with everyday disputes. These institutions already exist in one form or another in many jurisdictions, but not in Canada. Before exploring the potential of lay courts to provide a person-centred dispute-resolution service while protecting and even reinforcing the courts’ public function, it may be helpful to give a brief overview and an example of that type of institution.
Lay courts are courts in which judges are laypeople—that is, people who are not required to have any form of legal training or experience before their appointment and who perform their judicial duties on a part-time basis.Footnote 143 This model stands in contrast with professional courts, which employ judges who have extensive legal training and experience, and perform their judicial duties on an exclusive, full-time basis.Footnote 144 Lay courts are one of the many forms through which laypeople may participate in the administration of justice. Recent worldwide overviews of lay judges in criminal and civil matters have concluded that a majority of jurisdictions rely on lay judges in one form or another, such as through juries or mixed courts.Footnote 145 However, as further explained below, the form of lay justice that might hold the most significant potential in terms of person-centredness is lay courts that are composed entirely of lay judges, which usually operate locally and deal with everyday disputes.
Lay courts vary in their exact roles and features, but the example of the lay magistracy of England and Wales illustrates the phenomenon. Composed of more than 12,000 volunteer laypeople, the lay magistracy is part of the lower tier of the country’s judiciary.Footnote 146 It deals with more than 90 percent of all criminal matters as well as a wide range of civil matters that are related to family disputes and the collection of local taxes.Footnote 147 Appointed by the judiciary on the advice of local advisory boards,Footnote 148 lay magistrates sit in panels of three in most cases,Footnote 149 with the assistance of a legally trained clerk.Footnote 150 These lay courts are similar to their professional counterparts in that they provide the same service of law-based adjudication as the public justice system. However, as detailed below, they differ in significant respects, allowing lay courts to provide a service that is better centred on people and their needs.
2. From Professional to Lay Courts: A Person-Centred Shift
This section compares professional and lay courts regarding aspects that are most relevant to person-centred justice. It does not claim to provide an exhaustive comparison of their features, benefits, and costs, but points to a different model of courts that might provide a public dispute-resolution service that is centred on the person.
One of the central themes of person-centred justice, as discussed in the first part of this article, is the accessibility of legal and justice services. From that perspective, the local presence of lay courts often makes them more accessible than professional courts. The reliance on laypeople limits the resources that are needed for lay courts to function, if only because lay judges are usually volunteers whereas professional judges receive salaries that are commensurate with their role and expertise.Footnote 151 In England and Wales, for instance, lay magistrates have been found to cost about 50 percent less than professional courts to perform the same work.Footnote 152 Lower costs are important because there can be about twice the number of lay courts for the same investment, allowing greater decentralization and accessibility for local communities. The local aspect of lay courts is apparent in England and Wales, where lay magistrates are assigned to a specific “local justice area” in or near which they must either live or work and where they are much more present than professional judges.Footnote 153
Lay courts also tend to be more accessible from a procedural standpoint, offering a service that is more understandable, welcoming, and responsive to the parties’ needs and, therefore, they are more flexible. Because of their training, professional judges tend to adopt a legalistic approach to disputes that formats human stories to make them fit legal categories.Footnote 154 In addition, their full-time judicial duties often lead to routinization and case-hardening, which compound this legalistic approach.Footnote 155 As a result, “legal systems and formal legal institutions can be difficult to navigate, and in some cases be intimidating for ordinary people.”Footnote 156 By contrast, empirical studies have shown that lay judges often adopt a more welcoming approach that uses less technical language and embraces the litigants’ stories in all their complexity, even if their decisions remain based on law.Footnote 157 This different approach has been observed in England and Wales, where lay magistrates are perceived as making the proceedings more understandable and welcoming.Footnote 158 Such a result reflects the objectives of person-centred justice because it casts dispute resolution as a service that helps people to resolve their issues more holistically and flexibly, not as a technical process for resolving legal problems. As various authors have noted, this type of interpersonal interaction between litigants and decision-makers is essential to improving the parties’ experience and their perception of the fairness of the process—two goals that are aligned with person-centred justice.Footnote 159
This different approach to the judicial process also contributes to empowerment—another of the key themes of person-centred justice. As noted above, the more welcoming approach of lay judges gives parties more flexibility and, therefore, more control over how they participate in the judicial process. But, beyond the parties, lay courts empower community members to resolve their peers’ disputes. By mirroring experiences in participatory democracy, which have been shown to “enhance citizens’ sense of political efficacy and empowerment,”Footnote 160 lay courts similarly contribute to the sense of empowerment of community members. This focus is reflected in the English and Welsh lay magistracy. One of the justifications for maintaining the institution over time has been precisely the fact that it allows thousands of people to participate in the administration of justice.Footnote 161 Participation is not only sought as an end in itself; it also aims to reinforce “the fabric of society” by creating links among magistrates and between them and their communities.Footnote 162 A study confirmed that one of the perceived strengths of lay magistrates is their association “with a greater degree of democracy.”Footnote 163
Finally, because of their empowering effect on local communities, lay courts also contribute to the objectives of local and community-based justice. Professional judges cannot pursue many activities outside the courtroom because of their full-time judicial workload and may, for that reason, become isolated from their community.Footnote 164 By contrast, lay judges who perform their judicial duties part-time contribute to society off the bench in many ways. They often hold other jobs and they may volunteer in community organizations. Those activities allow them to be in constant contact with the people in the communities that they serve, preventing them from becoming socially isolated and allowing them to gain valuable “real-life” experience that they then bring to bear in the exercise of their judicial duties.Footnote 165 In addition, the fact that part-time lay judges handle fewer disputes makes them less vulnerable to case-hardening. In England and Wales, for instance, there is evidence “that the part-time nature of magistrates’ work may go some way towards limiting their ‘cohesiveness’ in the court process, which can provide an important safeguard against the formation of ‘clique’-based mentalities and case-hardening.”Footnote 166 The links between lay courts and the communities that they serve are a key feature of the English and Welsh lay magistracy, which authors have described “as local justice delivered by selected members of the local community.”Footnote 167
By embodying these different themes of person-centred justice, lay courts might help the justice system to achieve the objectives that were described previously, including the rebuilding of trust in justice institutions and strengthening of the social fabric and democracy. With the participatory opportunity that it affords local community members and its ability to offer a judicial process that is more responsive to litigants’ needs, the lay magistracy of England and Wales, for instance, has been found to provide a legitimate forum for resolving disputes.Footnote 168 In short, lay courts closely align with person-centred justice while remaining public institutions, and thus provide one potential avenue for resolving the tension that has been identified previously between the private and public functions of dispute resolution.
3. Responding to the Challenges that Lay Courts Face
For all their potential benefits, the implementation of lay courts in modern societies comes with significant challenges. Several concerns might be raised, including the effects of a de-formalization of the judicial process, the integration of these courts with professional courts through appeals or judicial review, the safeguards that are required to ensure that lay courts do not become a second-class dispute-resolution mechanism for disadvantaged groups, and many other challenges that can be resolved in large part through careful attention to the institutional design of these courts.Footnote 169 In this last section of the article, I focus on two of the main challenges that lay courts face, which pertain to the lay judges’ competence and independence.
In terms of competence, most modern societies are “law-thick,” meaning that law pervades most aspects of life.Footnote 170 The growing complexity of legal enactments poses a challenge for lay judges, who have no legal training or experience in finding, interpreting, and applying legal concepts.Footnote 171 They may be provided with some training, and a legally trained clerk may even support them—as is the case with English and Welsh lay magistrates—but these support mechanisms are not enough for lay judges to deal with complex legal matters in the same way as legal professionals.
However, this concern for judicial competence is largely irrelevant in straightforward disputes. Consider, for instance, Desaulniers Footnote 172—a debt collection dispute of the type that our small claims courts frequently hear—which involved a creditor who was suing a debtor for having defaulted on a loan. In that case, the applicable rules were simple and easy to retrieve. In fact, the judge who handled that dispute cited no rule of law in his decision, referring only to the general notion of breach of contract. In terms of legal reasoning, simple cases like this one frequently call for deductive reasoning rather than complex legislative interpretation or factual categorizations.Footnote 173 As a result, studies in psychology suggest that, in these cases, laypeople are as capable of reaching rational conclusions in accordance with applicable law as professional judges.Footnote 174 Indeed, a study of New York lay judges who were entrusted with the resolution of minor and usually simpler criminal and civil matters showed essentially no difference in reasoning compared to professional judges, especially with respect to their attention to legal rights and due process.Footnote 175
The challenge, then, to ensure that lay justice is a successful complement to other dispute-resolution mechanisms is to shift away from our current one-size-fits-all approach and embrace a method that considers the nature and complexity of each dispute. Doing so requires triage mechanisms that can identify whether a dispute lends itself to lay adjudication or whether it is too legally complex and needs the intervention of a professional judge.Footnote 176 These mechanisms, which are often managed by professional actors (e.g., judges or clerks), already exist in England and Wales and other jurisdictions. Moreover, this way of organizing our public dispute-resolution institutions aligns with person-centred justice. As an official of the OECD recently noted, an understanding of people’s different legal needs naturally leads to a recognition that we need “a wide range of dispute resolution mechanisms capable of dealing with a variety of needs.”Footnote 177 With that shift, we may recognize that it can be counterproductive to use professionals to resolve simple everyday disputes.
A second concern that arises with lay justice is the maintenance of judicial independence. Judicial independence can be defined as “the capacity of the courts to function without actual or apparent interference by anyone, including in particular the legislative and executive branches of government.”Footnote 178 It is essential to the judiciary’s impartiality and, in turn, to its legitimacy. Judicial independence, therefore, must be a key component of any person-centred conception of justice.Footnote 179 The lay judges’ part-time office can pose a challenge in that respect. First, because they must make a living outside of their judicial duties, their extrajudicial entanglements may give rise to conflicts of interest. Second, there is a risk that the executive may influence the assignments of part-time lay judges. For example, the executive may provide more sitting days to judges who are responsive to the demands of government actors and limit the number of sitting days of judges who are considered less favourable to them, as was once the case with Canada’s justices of the peace.Footnote 180
However, a full-time office is not the only way to curtail these risks; other safeguards can effectively protect lay judges’ judicial independence. For instance, the power of assigning sitting days to lay judges might be taken away from the executive and entrusted to one of the lay judges or an independent officer.Footnote 181 In addition, strict requirements should be imposed on lay judges through a code of ethics to clarify their standards of conduct and to ensure that they recuse themselves when conflicts of interest arise.Footnote 182
Therefore, while concerns about lay judges’ competence and independence are justified, lay courts can be designed to ensure that they only deal with legally simple cases and do so independently and impartially.
Conclusion
One of the most potent aspects of person-centred justice is its instinctive appeal across various constituencies. As Iavarone-Turcotte noted, the idea of centring justice services on the person garners broad support, not only among observers of the justice system, but also within the system itself.Footnote 183 This support is no small feat when one considers the resistance to change in legal circles.
However, if person-centred justice is to guide justice reforms, then we must define it clearly and better understand its implications. This article has sought to refine the definition of person-centred justice through a reflexive thematic analysis of the literature. It has argued that, while person-centred justice sets clear objectives that are in line with people’s documented needs, its application to dispute resolution raises issues of a different type that must be balanced with a person-centred approach. Notably, a narrow focus on people’s needs could lead to the privatization of dispute resolution, with significant risks to its public function. This concern need not be opposed to person-centred justice, but it has the potential to refine our understanding of that concept. Concretely, this article has suggested that lay courts could provide one of several potential paths to the offering of person-centred dispute-resolution services while preserving the public function of the justice system. Set in local communities, lay courts have the potential to bring an accessible, flexible, and holistic dispute-resolution forum to the population, empowering them both as parties and behind the bench.
Beyond what has been explored in this article, person-centred justice raises many more questions that have yet to be addressed. For instance, similarly to most of the literature on person-centred justice, this analysis assumes that the person who is seeking help is an individual. Yet, justice systems also serve legal persons. In recent documents on person-centred justice, the OECD centres on the needs of individuals and small and medium enterprises, but not of large businesses.Footnote 184 This choice is value-laden and suggests the need to clarify the assumptions on which person-centred justice is built. Much work remains to be done, but person-centred justice does have the potential to catalyze change.