No CrossRef data available.
Published online by Cambridge University Press: 01 August 2023
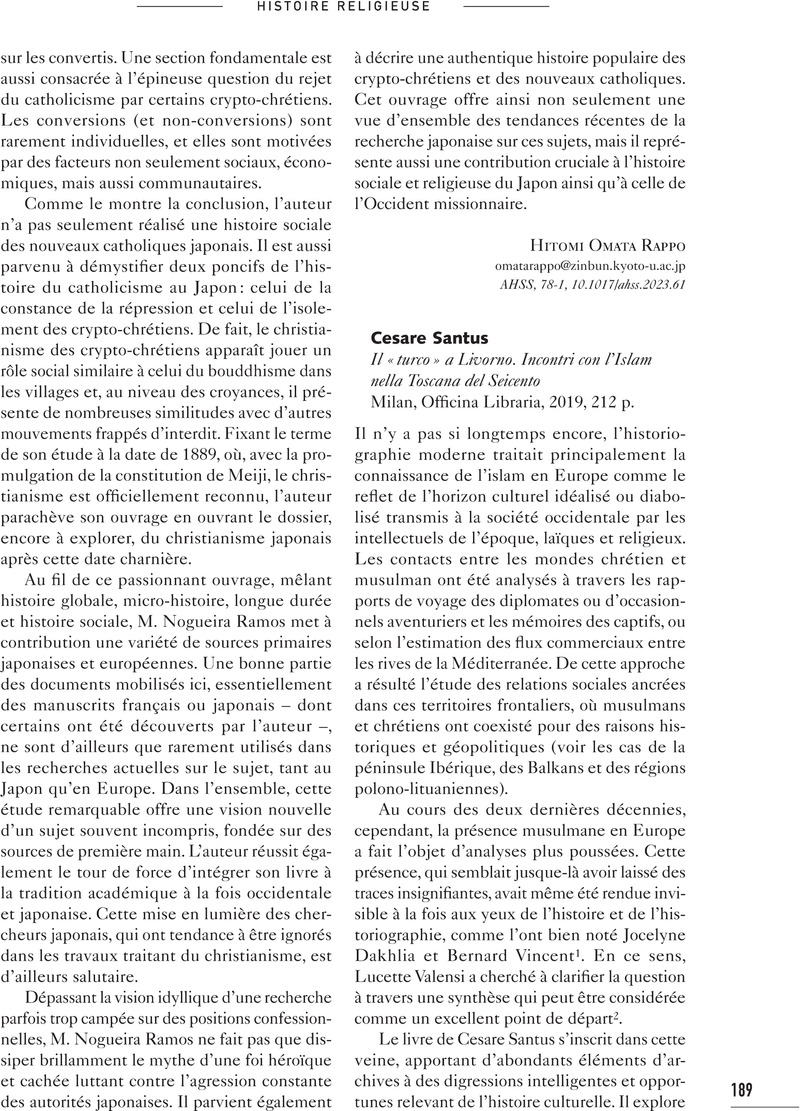
1 Jocelyne Dakhlia et Bernard Vincent, Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 1, Une intégration invisible, Paris, Albin Michel, 2011.
2 Lucette Valensi, Ces étrangers familiers. Musulmans en Europe ( xvie- xviiie siècles), Paris, Payot & Rivages, 2012.
3 Celui qui s’est vendu pour un certain temps à la rame, sans avoir été contraint.
4 Bernard Lewis, Islam and the West, New York, Oxford University Press, 1994.